02/01/2011
(UK) Upstairs Downstairs : Maîtres et Valets dans l'agitation londonienne de 1936

La dernière semaine de 2010 (du 26 au 28 décembre) aura permis à BBC1 de proposer son propre period drama se déroulant dans la première moitié du XXe siècle. Remake, ou plutôt suite, d'un classique des années 70, Maîtres et Valets, qui avait fait les beaux jours d'ITV, Upstairs Downstairs allait, en raison de sa programmation, fatalement subir les comparaisons de la grande réussite de l'automne de... ITV, Downton Abbey. On le pressentait d'emblée, le parallèle - pas forcément des plus justifiés tant l'époque et les enjeux diffèrent, mais qui s'impose malgré toute la bonne volonté du téléspectateur - n'a pas tourné en faveur de la BBC. Car oui, qui l'eut cru, mais nul doute que ITV l'a bien emporté sur la BBC en 2010 dans ce créneau très prisé des reconstitutions historiques...
Pour autant, Upstairs Downstairs mérite plus qu'être seulement balayée par le triomphe de celle qui l'a précédée. Proposée en trois épisodes d'une heure chacun, elle a tout d'abord semblé cumuler les handicaps, avec en plus une entrée en matière ratée, flirtant avec une étrange nostalgie de transition peu opportune. Mais, en dépit d'une introduction malaisée, la série va progressivement réussir à dépasser ses tergiversations initiales. Les deux derniers épisodes vont en effet gagner en intensité comme en intérêt.

Upstairs Downstairs s'ouvre en 1936 peu avant la mort du roi George V. Sir Hallam Holland, un diplomate, et son épouse, Lady Agnes, s'installent au 165 Eaton Place, la demeure qui fut le cadre de Maîtres et Valets. Le jeune couple, décidé à compter dans le quotidien de la haute société londonienne, a la surprise - pas forcément agréable - de voir arriver quelques jours plus tard, Lady Maud, la mère de Hallam, laquelle souhaite, après plusieurs décennies passées hors d'Angleterre, venir finir d'écrire ses mémoires sur place. La soeur d'Agnès, Persephone, les rejoint également. Venue de la campagne du Pays de Galles pour apprendre les bonnes convenances au sein de l'aristocratie londonienne, elle va en même temps découvrir un autre monde, celui de la politique et des idéologies.
La carrière de diplomate de Hallam dépendant également des connexions sociales sur lesquelles il doit pouvoir compter, Lady Agnes est bien consciente de la nécessité d'avoir à disposition un staff complet. Elle embauche pour cette tâche Rose Buck, qui fera le lien avec l'ancienne série, ayant servi les Bellamy jusqu'en 1930, année où s'était achevée l'histoire de Maîtres et Valets. C'est ainsi un personnel très divers, mais finalement aussi relativement restreint ce qui permet une certaine solidarité, qui va finalement être assemblé, même s'il connaîtra quelques aléas au fil des évènements de la série.
Pour nous plonger dans la vie londonienne de 1936, Upstairs Downstairs va mêler la grande Histoire aux histoires personnelles de ses protagonistes. Tandis qu'en toile de fond, l'Allemagne Hitlérienne inquiète des diplomates qui hésitent sur la position à adopter, sur le sol anglais, la série s'arrête sur la politique intérieure, avec la tentation fasciste que représente Oswald Mosley et la British Union of Fascists. Parallèlement, la famille royale entretient aussi toutes les conversations. Si Edouard VIII a succédé à son père, George V, sa liaison avec une américaine, Mrs Simpson, posent question : le choix entre le trône et une femme se profile à l'horizon.

Après la démonstration proposée par Downton Abbey au cours de l'automne, Upstairs Downstairs était forcément attendu au tournant. Peu importe que le contexte, les lieux ou l'approche des scénaristes soient différents ; peu importe que les deux séries ne s'inscrivent pas dans la même optique et ne partagent pas les mêmes ambitions, notamment au niveau de l'esthétique... Car demeurent quelques fondements clés : le cadre de la haute aristocratie britannique, dans une maison où l'on suit la vie des maîtres des lieux comme des serviteurs. Les parallèles se font naturellement dans notre esprit, souvent même en dépit des efforts du téléspectateur pour essayer de découvrir avec un regard neutre Upstairs Downstairs. On est ici loin du château plein de vie de Downton Abbey. En découvrant le staff, on songe, malgré nous, qu'il est finalement bien peu fourni. Là où la série d'ITV créait une sorte de communauté, Upstairs Downstairs pose un environnement plus proche du téléspectateur et qui se rapproche parfois d'une sorte de huis clos à taille humaine.
Pourtant, ce n'est pas l'ombre de Downton Abbey qui va poser le premier problème que rencontre Upstairs Downstairs. Certes, durant le premier épisode, le téléspectateur se laisse aller à égréner dans son esprit, toutes ces différences que son esprit fait par pur réflexe - la plupart n'étant pas favorables a priori à la fiction de la BBC. Mais s'il prend le temps de réaliser cet exercice de comparaison, au-delà du calendrier de diffusion, la faute en revient en grande partie aux propres scénaristes de la série. Car Upstairs Downstairs débute de manière excessivement poussive, par une longue et lente installation qui fait office d'introduction, occupant les trois premiers quarts d'heure, et au cours de laquelle elle essaye de façon assez maladroite de toucher la fibre nostalgique du téléspectateur. Si j'admets sans difficulté que Maîtres et Valets constitue une institution télévisuelle, elle date quand même de trois décennies. Plus que capitaliser sur un nom mythique, l'objectif principal aurait clairement dû être de conquérir et de toucher un nouveau public, non familier avec cet univers. Or, ce nouveau public ne va pas s'émerveiller sur les longs plans montrant Rose Burke redécouvrant cette maison dans laquelle elle a servi. Cette lente mise en place des personnages et des enjeux donnent l'impression de sacrifier la première heure de narration, qui échoue donc dans le but inhérent à tout pilote : celui de captiver l'attention du téléspectateur. Les dernières minutes et la réception gâchée par l'invitation non intentionnelle du dignitaire nazie offriront les premières petites étincelles qui laissent entrevoir le potentiel dont dispose à l'évidence le récit de la vie de cette maisonnée. La suite va plutôt donner raison au téléspectateur qui aura été patient, sans pour autant pleinement satisfaire.

Si Upstairs Downstairs ne se départit jamais totalement de cette impression que ces trois épisodes ne constituent qu'une forme de mise en bouche, une introduction qui cherche le bon équilibre tout en promettant une suite plus aboutie, les deux heures suivantes vont se révéler beaucoup plus denses et intenses dans les histoires qui s'esquissent. Certes, les rapports entre les différents protagonistes restent relativement prévisibles, les personnages mettent un peu de temps à s'affirmer individuellement et à acquérir une dimension humaine, cependant le côté très choral de la série va être celui qui va fonctionner le premier. Paradoxalement, avant même de s'attacher aux protagonistes, c'est ainsi le cadre et l'univers mis en scène qui retiennent notre attention. Upstairs Downstairs a la chance de se dérouler en 1936 et donc de disposer en toile de fond d'une situation géopolitique, mais aussi intérieure, très trouble, qui ne va pas épargner la maisonnée.
C'est donc par les éléments qui détonnent au sein de ce milieu policé que la série s'affirme tout d'abord, que ce soit à travers le destin personnel de certains personnages, comme la servante juive allemande, ou l'implication politique d'autres membres de la maisonnée, telle la jeune Perséphone ou bien le chauffeur (dans une relation n'étant évidemment pas sans évoquer au téléspectateur celle de Sybil et de son chauffeur ; le fascisme ayant remplacé le socialisme). Si la narration manque trop souvent de subtilité dans sa façon de romancer l'Histoire afin de permettre la rencontre des petites et de la grande, la maîtrise du rythme de l'écriture étant aussi très perfectible, j'avoue avoir vraiment apprécié cet effort d'immersion dans le contexte particulier de l'Angleterre de la fin des années 30. Que ce soit la question du nazisme (la reconstitution de la Bataille de Cabble Street est assez impressionante) ou l'abdication d'Edouard VIII, Upstairs Downstairs s'efforce, avec plus ou moins d'habileté, de nous montrer les réactions diverses des Anglais de l'époque, à travers toute la diversité d'opinions et de milieux représentés dans cette demeure du 165 Eaton Place.
Au final, c'est donc par sa volonté de retransrire la société de son temps et de s'inscrire dans ses enjeux qu'Upstairs Downstairs capte en premier lieu l'intérêt du téléspectateur. Le temps aidant, les personnages s'humanisent progressivement, permettant, au cours du troisième épisode, de trouver peu à peu un semblant d'équilibre satisfaisant dans la maisonnée. L'atmosphère apparaît plus intimiste que dans Downton Abbey. Il y a une solidarité forte qui se crée finalement entre tous les habitants, qui confère une proximité absente de la série de ITV. Je pense donc qu'il y a bien la place pour Upstairs Downstairs dans les programmes britanniques de l'an prochain, à condition de poursuivre sur les bases auxquelles parvient enfin la fin du dernier épisode et en soignant l'homogénéité globale d'un récit trop éclaté.

Sur la forme, Upstairs Downstairs fait preuve d'une grande sobriété. Le clinquant de certains décors reste étonnamment tempéré par une mise en scène toute en retenue, qui s'inscrit dans cette ambition un peu vaine de poursuivre l'oeuvre de Maîtres et Valets et d'en appeler donc à une forme de nostalgie. La réalisation, comme la musique en arrière-plan, marquent donc par leur relative neutralité d'ensemble. Le visuel n'a rien de l'esthétique aboutie et fascinante de Downton Abbey ; ce qui lui permet au moins de clairement s'en différencier sur ce plan.
Pour mettre en scène ce récit pas toujours très homogène, le casting se révèle solide, même si certains vont rester un peu en retrait. C'est une conséquence de la difficulté que connaît la série pour bien s'installer et donner vie et, surtout, une personnalité propre et définie à chacun de ses personnages. Le couple Holland est très bien interprété par Ed Stoppard (Any human heart) et Keeley Hawes (Spooks, Ashes to Ashes). A leurs côtés, Claire Foy (Little Dorrit, Going Postal) n'a pas un personnage facile, mais elle est, comme toujours, lumineuse dans certaines scènes. Signe de l'héritage qu'elle revendique, on retrouve également au casting les deux actrices qui eurent l'idée du concept à l'origine de Maîtres et Valets au début des années 70 : Eileen Atkins (La taupe, Psychoville) incarne Lady Maud, tandis que Jean Marsh (Doctor Who) retrouve (assez paradoxalement puisque 6 ans se sont "fictivement" écoulés, mais 30 ans dans la réalité) son personnage d'origine, Rose Buck. Parmi les autres membres du staff, on retrouve d'autres habitués du petit écran britannique, comme Anne Reid (Bleak House, Five Days), Nico Mirallegro (Hollyoaks), Neil Jackson (Flashforward, Make it or break it), Adrian Scarborough (Cranford, Psychoville, Gavin & Stacey) ou encore Art Malik (Holby City, The Nativity). Enfin, en ce qui concerne les acteurs plus secondaires, en dehors de la maison, je citerais la présence de Blake Ritson (Emma) que j'ai retrouvé avec beaucoup de plaisir, en frère inquiet du futur roi abdicateur et ami proche du maître de maison.

Bilan : Ne se départissant jamais de cette impression qu'il s'agit seulement d'une introduction à une série à venir, les trois heures d'Upstairs Downstairs vont permettre à la série de progressivement s'affirmer, gagnant en densité narrative et en intensité émotionnelle. Mais si elle exploite à propos le contexte particulier de cette année 1936, elle peine à trouver ce liant nécessaire entre les différentes storylines qui aurait permis un récit homogène. Si Upstairs Downstairs propose donc des histoires trop éclatées et relativement prévisibles, elle laisse cependant entrevoir un réel potentiel qui peu à peu, trop lentement, semble se construire.
Sans occulter ces défauts, j'avoue avoir pris du plaisir à regarder les deux dernières heures, après m'être un peu ennuyée devant la première. J'ai donc envie d'espérer que la série puisse aller crescendo et nous proposer une suite plus aboutie.
NOTE : 7/10
La bande-annonce :
18:54 Publié dans (Pilotes UK), (Séries britanniques) | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : bbc, upstairs downstairs, ed stoppard, keeley hawes, jean marsh, eileen atkins, claire foy, anne reid, nico mirallegro, neil jackson, adrian scarborough, art malik, blake ritson | ![]() Facebook |
Facebook |
28/11/2010
(UK) Garrow's Law, series 2 : un passionnant legal drama au XVIIIe siècle

Ce mois de novembre était synonyme de retour pour plusieurs séries que j'avais pris plaisir à suivre l'an dernier. Si je partage plus souvent sur ce blog mes réactions au sujet des dernières nouveautés téléphagiques, il faut y voir plus l'excitation de la découverte (et un arbitrage brise-coeur pour choisir les sujets des critiques) qu'un désintérêt pour ces séries entamant leur deuxième, voire plus avancée, saison. A la télévision britannique, ce sont les inédits de deux fictions extrêmement différentes que j'attendais avec une relative impatience ; l'ambiance inimitable, vaguement déglinguée, des héros de Misfits et l'atmosphère embrumée des prétoires du XVIIIe siècle, théâtres des passes d'armes initiées par William Garrow, avec Garrow's Law.
On parle pas mal de la première sur les réseaux sociaux que je fréquente, beaucoup moins de la seconde, ce qui m'attriste bien. En ce qui me concerne, je ne vous cache pas que j'avais actuellement sans doute plus besoin d'un solide legal drama dans lequel m'investir. C'est donc l'occasion ou jamais de rappeler la série à notre bon souvenir. D'autant plus que, quoi de plus opportun que de mettre le XVIIIe siècle à l'honneur cette semaine ? Car vendredi prochain marque le retour d'une des séries françaises que j'attends et aime à savourer toujours avec beaucoup de plaisir : Nicolas le Floch.

Au cours des dernières semaines, j'ai pu lire ou assister, voire prendre part, à certains débats sur l'opportunité des reconstitutions historiques télévisées (notamment au sujet de Boardwalk Empire). Je ne vous cache pas que je reste dans une certaine incompréhension face aux enjeux de cette problématique qui ferait des séries se déroulant dans le passé une sorte de sous-genre, où la valeur-ajoutée scénaristique se réduirait au seul aspect folklorique des décors, subterfuge censé aveugler le sens critique de ses téléspectateurs. A défaut de comprendre tous les arguments, j'ai au moins pu cerner un des reproches adressés à cette catégorie, qui pourrait se schématiser ainsi : faire de l'historique, pour de l'historique, en oubliant de construire une histoire. Face à ces critiques, j'ai envie de simplement revenir sur ce premier épisode de la saison 2 de Garrow's Law, qui a été diffusé le 14 novembre dernier sur BBC1.
Reprenant avec maîtrise son fil narratif, la série réintroduit efficacement chacun de ses personnages dans leur vie personnelle et professionnelle, retrouvant rapidement un équilibre entre ces deux sphères, dans la droite continuité de la saison passée. Tandis que Lady Sarah Hill renoue avec son époux, miné par la gangrène d'une jalousie dévorante qui l'amène à se persuader que l'enfant de Sarah n'est pas le sien, mais le fruit des fidélités de sa femme avec William Garrow, des assureurs de Liverpool contacte ce dernier pour une question de fraude à l'assurance touchant un commerce particulier : la traite d'esclaves. Un navire s'est en effet débarrassé de 133 esclaves, les jetant à la mer, après avoir risqué d'être à court d'eau potable. Mais cette perte financière, indemnisée initialement et conséquence d'un voyage plus long que prévu, serait due à la faute du capitaine, non aux intempéries maritimes.

S'il est une chose qu'il faut saluer dans Garrow's Law, ce n'est pas seulement la rigueur avec laquelle elle s'attache à faire revivre le parfum des prétoires du londonien Old Bailey, mais c'est aussi la manière dont elle réussit à nous dépeindre l'esprit d'une époque et les raisonnements qui y ont cours. Le tribunal s'apparente à une scène de théâtre, où les acteurs judiciaires présentent un spectacle dans lequel le public, omniprésent par ses réactions, occupe également une place centrale. Dans cette optique, tout en nous dépeignant des procès, dont certains s'assimileraient plus à une parodie amère de justice, la série s'est toujours beaucoup attachée à nous relater les rouages d'un système judiciaire, socialement discriminatoire, où la défense est le plus souvent privée de tous droits.
Par ce fait qu'elle va mettre en lumière un autre équilibre entre les acteurs judiciaires, où les différences procédurales par rapport aux legal dramas contemporains sauteront aux yeux du téléspectateur, Garrow's Law trouve une résonnance particulière, bien plus moderne que les pourfendeurs des séries historiques ne pourraient l'imaginer. Qu'est-ce que le droit, si ce n'est un mouvement de balancier permanent, symptomatique d'arbitrages incessants et de recherches d'équilibres entre des intérêts divergents. En relatant cette genèse de la prise en compte de nouvelles figures sur la scène judiciaire, en assistant à l'introduction de préoccupations jusqu'alors inexistantes, la série nous invite certes à découvrir un processus historique que les réflexions du tourbillonnant XVIIIe siècle ont amorcé. Mais elle permet aussi, par contraste, de révéler des enjeux fondamentaux, inhérents à tout système judiciaire ; des bases sur lesquelles les séries modernes ne prennent pas forcément le temps d'insister, tout simplement parce qu'elles les considérent, à tort ou à raison, comme de simples acquis anecdotiques.
Garrow's Law n'est pas seulement une reconstitution historique, c'est une déconstruction et mise au grand jour des rouages de la justice ; un apport intemporel, bien loin de ces idées "folklores télévisés costumés" dans lesquels certains tendent à réduire ces fameuses séries historiques.

A ce titre, ce premier épisode de la saison 2 propose un retour solide, en offrant un éclairage, non pas tant sur des questions de procédure, que sur le statut de l'esclave. Le gouffre entre l'atrocité des faits commis et l'angle juridique proposé dans l'affaire du jour jette incontestablement un voile moral trouble sur l'affaire, William Garrow étant mandaté pour plaider une simple fraude à l'assurance, qualification juridique profondément déshumanisée qui laisse le téléspectateur glacé, alors que ce sont 133 êtres humains qui ont été jetés, sans arrière-pensée, à la mer. Ces morts ne sont prises en compte que sur un plan strictement patrimonial, tandis que viennent se greffer, en toile de fond, des enjeux commerciaux et géopolitiques qui amènent des personnalités politiques à intervenir. Comme attendu, le procès prend une tournure particulière à partir du moment où Garrow essaye de replacer dans les débats cette notion d'humanité obstinément exclue par le droit. Mais la conclusion sera à l'image de cette première affaire à l'arrière-goût désagréable.
Si la thématique du jour se révèle pesante, tout en étant traitée de manière rythmée et très convaincante, ne laissant aucun répit à un téléspectateur dont l'attention ne faiblit jamais, la force de Garrow's Law, c'est aussi le fait de ne pas oublier d'apporter une touche humaine à ce tableau de la justice anglaise du XVIIIe siècle, en s'intéressant à la vie personnelle de ses personnages. Non qu'il y ait une réelle originalité dans le traitement des relations qu'elle met en scène, mais cela a le mérite d'offrir un pendant au judiciaire, permettant des parenthèses bienvenues. Cependant, dans l'épisode du jour, l'atmosphère y est tout aussi lourde, abordant peut-être un point de non-retour dans les chaotiques aspirations amoureuses de William Garrow. Car voilà Lady Hill en fâcheuse posture, possiblement ruinée financièrement et socialement, si son mari poursuit la procédure de séparation particulière qu'il semble avoir choisie. Ce volet de la narration risque de ne pas être très reposant non plus dans les prochains épisodes.

Si le fond est solide, bénéficiant d'un sujet passionnant, la forme ne dépareille pas. La photographie, soignée mais dont les couleurs restent d'une sobriété travaillée, est à l'image, un peu grise, vaguement terne, de cette justice ambivalente ainsi mise en scène. La réalisation est travaillée, proposant des plans intéressants. Sans avoir pour objectif d'être un de ces costume drama censés éblouir, Garrow's Law offre une immersion qui sonne juste et une reconstitution sérieuse à saluer.
Enfin, le dernier atout fondamental de la série réside incontestablement dans son casting, à commencer, surtout, par son acteur principal, Andrew Buchan (Party Animals, Cranford, The Fixer), que ce rôle aura vraiment consacré à mes yeux. Son interprétation de cet avocat qui, au-delà de ses idéaux, n'hésite pas à s'investir pleinement et à se battre judiciairement pour ce en quoi il croit, est vraiment très convaincante. A ses côtés, on retrouve d'autres têtes familières du petit écran britannique, comme Alun Armstrong (Bleak House, Little Dorrit), Lyndsey Marshal (Rome, Being Human), Rupert Graves (Midnight Man, Sherlock, Single Father), Aidan McArde (All about George, Beautiful People) ou encore Michael Culkin (Perfect Strangers).

Bilan : Garrow's Law dispose de tous les attributs qualitatifs d'un solide legal drama, son atout supplémentaire - et par là même, sa pointe d'originalité - étant que la série se déroule au XVIIIe siècle. Sans opérer de révolution narrative particulière, elle s'attache avec beaucoup de soin à dépeindre une époque judiciaire particulière, sujette à des mutations fondamentales, et où de nouvelles préoccupations apparaissent, reflet des tourbillonnements idéologiques de cette période.
Au final, si elle ne peut sans doute pas être qualifiée d'incontournable, elle remplit de façon convaincante les objectifs non démesurés qu'elle s'était fixée : une reconstitution déconstruisant, avec une résonnance à la fois historique et intemporelle, les rouages d'un système judiciaire. C'est amplement suffisant pour mériter le détour.
NOTE : 7,5/10
Le générique de la série :
(Merci à Critictoo)
La bande-annonce de la saison 1 :
12:02 Publié dans (Séries britanniques) | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : bbc, garrow's law, andrew buchan, rupert graves, alun armstrong, lyndsey marshal, aidan mcardle, michael culkin | ![]() Facebook |
Facebook |
18/11/2010
(UK) Downton Abbey, series 1 : un period drama aussi savoureux que luxueux
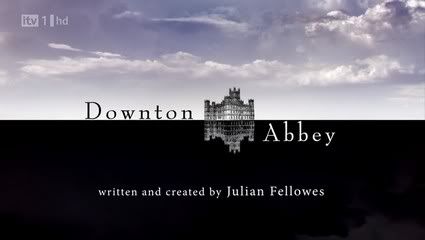
Meilleure nouveauté téléphagique anglo-saxonne de cet automne 2010, il était proprement inconcevable que je ne prenne pas le temps de rédiger une review en forme de bilan, tressant les louanges d'une des grandes et belles surprises de cette rentrée que fut Downton Abbey.
Succès public chaque dimanche soir sur ITV1, où elle a fédéré le public anglais en réalisant d'impressionnantes audiences, ce sera avec une plume d'autant plus légère que cette critique sera écrite. En effet, le téléspectateur a l'assurance de retrouver le quotidien de ce château et la vie de ses habitants l'an prochain, pour une saison 2, en bien des points parfaitement introduite par un final de saison 1 qui ouvre des perspectives narratives importantes, se concluant dans la torpeur de l'été 1914.

Si j'aborde cette review avec un entrain que j'espère communicatif, c'est que l'enthousiasme ressenti durant le visionnage du pilote de Downton Abbey ne s'est en réalité jamais démenti tout au long d'une saison, dont la richesse et la densité furent source d'une fascination constamment renouvelée pour cet univers codifié et coloré ainsi porté à l'écran. Où commencer, si ce n'est en évoquant la magie d'une écriture virevoltante et chatoyante, où les dialogues délicieusement ciselés se trouvent portés par une sobriété et une subtilité d'ensemble, qui construisent toute en nuances une atmosphère inimitable, que l'on ne peut réellement comprendre qu'en regardant un épisode.
Loin de la reconstitution historique descriptive et déshumanisée qui est un travers dans lequel tombent certaines fictions, c'est par sa vitalité revigorante que Downton Abbey s'illustre. Elle doit cela à la qualité de son écriture, mais également à la manière dont celle-ci va adopter une volatilité des tonalités des plus grisantes. Si la réalité de cette société rigide d'avant-guerre demeure une constante en arrière-plan, elle pèse sur les personnages sans jamais éteindre l'étincelle qui anime la série. Cette dernière demeure un drama au sens littéral du terme, mais la narration extrêmement vive lui permet d'alterner à bon escient, passages plus sombres, voire douloureux, et petits interludes résolument légers, où pointe un humour également tout en sobriété offrant une détente bienvenue au téléspectateur. L'intelligence et la vigueur des réparties de personnages toujours inspirés apportent une spontanéité, pleine d'authenticité, des plus prenantes. Si elle s'inscrit dans un registre tout en retenue, par cette forme d'imprévisibilité quelque peu enivrante qu'elle adopte, Downton Abbey se révèle ainsi plus pimentée que ce que son concept aurait pu laisser penser.

Cette ambiance rapidement addictive s'explique également par la dimension profondément humaine que développe la série. Car la réussite éclatante de Downton Abbey, c'est aussi de savoir instinctivement toucher le téléspectateur, d'être capable de l'impliquer immédiatement dans le quotidien du château en l'invitant à suivre les existences plus ou moins troublées d'une galerie de personnages particulièrement riche. Il règne comme une fausse impression de proximité vis-à-vis de chacun ; et si le téléspectateur se trouvera logiquement plus d'affinités avec les uns ou les autres, il s'investira pleinement dans les storylines, toutes plus ou moins liées, que la série présentera. Des jalousies plus ou moins maîtrisées aux peines de coeur, des problèmes d'argent aux basses vengeances qui ne rebuteront pas certains, c'est tout un quotidien coloré et intense, souvent passionné, voire passionnel, qui nous est dépeint. Si certains rebondissements pourront paraître à l'occasion un peu excessifs, le téléspectateur se laissera emporter sans peine par le souffle d'ensemble.
L'atout de Downton Abbey est de disposer de nombreux personnages qui sont, chacun, envisagés comme des individualités indépendantes, aux personnalités travaillées. Avec des figures fortes et quelques tempéraments hors normes, la série dispose d'un potentiel humain impressionnant qu'elle va s'attacher à pleinement exploiter, consciente qu'il représente une de ses forces. Certes, la série n'évitera pas l'écueil de quelques portraits plus unidimensionnels, qui pourront faire débat, comme Thomas, Mrs O'Brien ou encore l'attitude d'Edith. Mais le plus important demeure qu'à aucun moment, la série ne laissera indifférent un téléspectateur prompt à prendre parti dans les conflits qui s'esquissent ou les prises de position que certains adopteront. Par cet emploi à bon escient de ses personnages, et même si certains auraient gagné à être plus nuancés, la série réussit rapidement à gagner l'affectif du téléspectateur, acquérant un capital sympathie des plus confortables.

Cette animée galerie de personnages permet également à Downton Abbey d'assurer une reconstitution d'époque qui sonne authentique. Car cette fiction, à travers toutes les figures si diverses que le domaine rassemble, apparaît comme le reflet d'une société britannique en mutation, parcourue par des tensions, où le respect des traditions qu'incarne cette noblesse aux codes sociaux rigides, versant entre paternalisme et gouvernance, vient se heurter à l'apparition et à la consécration de nouvelles idées. Des suffragettes militant pour le droit de vote des femmes jusqu'aux socialistes, l'esprit tourné vers la lutte des classes, c'est au final un portrait excessivement riche et surtout très vivant d'une époque qui est dressé.
La série capte avec beaucoup de justesse ces frémissements vers les changements qui se font jour. C'est assez fascinant d'assister à l'évolution progressive des mentalités, particulièrement mise en exergue par ce parallèle que la série permet en faisant se côtoyer des protagonistes appartenant à des classes sociales si différentes. Car cette ébullition des idées conduit à terme à une émancipation inévitable, où chacun pourra ne plus considérer sa position sociale comme définitivement fixée ; une révolution des esprits dans un monde où pèse encore lourdement le poids d'une forme de prédestination des individus qui ne peuvent imaginer d'autres futurs que celui qui semble déjà tout tracé dès leur naissance. Avec la fraîcheur et la candeur qui lui sont propres, Sybil illustre à merveille toutes les ambivalences inhérentes à cette période de transition.

Period drama ambitieux et accompli sur le fond, Downton Abbey fait preuve de tout autant de maîtrise sur la forme. Dotée d'un accompagnement musical sobre des plus opportuns et s'ouvrant sur un générique qui donne immédiatement le ton et que l'on prend plaisir à retrouver, la série propose une magnifique reconstitution d'époque qui va ravir les yeux d'un téléspectateur immédiatement séduit par l'esthétique et la photographie de cette réalisation luxueuse. Au-delà des superbes costumes et d'un soin apporté aux détails de l'époque recréée, c'est sans doute le cadre du tournage qu'est ce château du Berkshire, le Highclere Castle, qui impressionne le plus, offrant un somptueux décor à l'histoire.
Enfin, il serait inconcevable de ne pas saluer le casting qui a donné vie à cette série. Un casting pour lequel il n'y a sans doute pas de compliments suffisamment louangeurs permettant de qualifier et d'applaudir la performance d'ensemble proposée. Parmi ces acteurs qui ont tous rempli avec beaucoup d'implication et de savoir-faire leurs rôles, s'il fallait n'en retenir que quelques-uns, je serais tentée de, tout d'abord, rappeler combien Maggie Smith est tout simplement extraordinaire à l'écran, combien Hugh Bonneville incarne à merveille cette figure parfaite du Lord ou encore combien Michelle Dockery a su prendre la mesure de l'ambivalence du personnage de Lady Mary. Mais ce serait injuste pour ceux que je n'aurais pas mentionné : donc saluons simplement cette réussite collective.

Bilan : Ambitieux period drama doté d'une écriture fine particulièrement bien maîtrisée, Downton Abbey est une réussite aussi bien visuelle que narrative. Derrière ses couleurs chatoyantes et ses dialogues savoureux, c'est une série profondément humaine dont les personnages, qui ne peuvent laisser insensibles, constituent le coeur. Délicieusement virevoltante, presque enivrante, elle s'impose comme une fiction aboutie, dépassant la simple reconstitution d'une époque pour parvenir à donner véritablement vie à ses protagonistes.
En somme, Downton Abbey se savoure sans modération. Une série à ne pas rater !
NOTE : 9/10
Le générique de la série :
20:41 Publié dans (Séries britanniques) | Lien permanent | Commentaires (6) | Tags : itv, downton abbey, julian fellowes, hugh bonneville, maggie smith, elizabeth mcgovern, michelle dockery, dan stevens, penelope wilton, jim carter, phyllis logan, siobhan finneran, joanne froggatt | ![]() Facebook |
Facebook |
28/10/2010
(UK) Whitechapel, series 2 : un polar noir étrangement intemporel

Ce lundi soir s'achevait, sur ITV1, la saison 2 de Whitechapel. Comme la première saison, un succès public considérable qui fut diffusé durant l'hiver 2009 (je signale au passage qu'un an et demi d'écart entre deux saisons, c'est beaucoup trop long pour ma mémoire), elle fut en tout composée 3 épisodes, formant un seul arc narratif, et ramenant à la vie la légende d'une figure de l'histoire criminelle britannique. A la différence de la première saison, l'audience fut moins au rendez-vous, tout en restant très honorable. La série a cependant été dominée par sa concurrente directe programmée sur BBC1, Spooks (MI-5).
Pour le reste, Whitechapel reprenait les mêmes ingrédients qui avaient fait la spécificité et la réussite (certes, avec ses défauts et maladresses) de son précédent cycle, qui avait été consacré à Jack l'Eventreur (The Ripper). On y retrouve donc tant cette atmosphère assez fascinante, vaguement intemporelle, que la dimension humaine qui en avaient fait le piquant. Ne bénéficiant plus de l'effet de surprise de la première, cette saison 2 s'affranchit sans sourciller de certaines contraintes narratives qui peuvent laisser une impression mitigée. Pourtant, dans l'ensemble, il est difficile de ne pas se laisser happer par ce récit.

Si la diffusion de la saison 1 remontait à plus d'un an et demi, c'est dans la continuité immédiate de celle-ci que s'ouvre cette seconde saison. Les conséquences et séquelles de l'affaire du copycat de Jack l'Eventreur sont encore visibles et les références à ces évènements parsèment tout l'arc. Cet héritage à assumer explique en partie la difficulté initiale à laquelle sont confrontés les scénaristes : réussir à introduire de façon crédible, et sans paraître sur-exploiter artificiellement le concept de base de Whitechapel, l'idée que, dans ce même quartier, des meurtres semblent, une nouvelle fois, être le fait de personnes se référant à d'anciennes gloires criminelles, et cherchant à se faire un nom. La série n'y parvient que de façon mitigée, s'empressant de repartir sur des bases similaires à l'excès, en faisant intervenir très tôt (peut-être un peu trop tôt) l'historien/documentariste qui les avait secondés dans leur précédente affaire. La légende des jumeaux Kray n'ayant pas forcément aussi bien traversé la Manche que Jack l'Eventreur, l'attrait mythique joue moins et il faut une partie du premier épisode pour véritablement se glisser dans les enjeux de la saison.
Les scénaristes se révèlent cependant plutôt astucieux. En effet, si c'est le cadavre, rejeté par la Tamise, d'un détenu échappé qui met les enquêteurs sur cette première piste qu'ils vont s'entêter à suivre jusqu'au bout, les transformations du paysage criminel londonien et le début d'évènements troublants remontent à plusieurs mois déjà. Et c'est en fait tout un quartier qui paraît vivre dans la peur au quotidien, confronté à une explosion de violences dont l'origine demeure protégée par une prudente loi du silence appliquée consciencieusement. Mais, à mesure que le DI Chandler et le DCI Miles, duo désormais parfaitement complémentaire, progressent dans leur investigations, ce sont des ramifications sans précédent, allant au-delà de la rue et des gangs, qui se dévoilent peu à peu. Ils vont soudain se sentir bien seuls dans cette guerre qu'ils initient contre un véritable système de compromission criminelle qui s'est mis en place. Peuvent-ils vraiment lutter contre ces fantômes des "jumeaux Kray" ? Le prix à payer ne sera-t-il pas trop élevé ?

Si cette saison 2 de Whitechapel laisse une impression ambivalente au téléspectateur, elle le doit au relatif manque de crédibilité de l'histoire mise en scène. Car il y a quand même une différence majeure dans la structure narrative par rapport à la saison 1. En effet, transposer l'oeuvre d'un serial killer d'un siècle à l'autre, hormis la prise en compte des progrès de la police scientifique, cela ne pose pas a priori de problème d'adaptation insurmontable. En revanche, tenter de faire revivre, en ce début de XXIe siècle, l'ambiance de la rue et du crime organisé des années 50 afin de consacrer des chefs de gangs d'un autre temps, c'est plus problématique. En un demi-siècle, c'est toute le réalité criminelle qui s'est profondément transformée. Pourtant, la série ne va pas hésiter à dépeindre un Londres de l'ombre quasi unifié sous la férule des Kray... Au-delà de cette homogénéité criminelle, le portrait de la police qui est dressé, aussi peu flatteur qu'il soit, renvoie également à des moeurs de compromission et de corruption dont les dynamiques émanent clairement d'une autre époque. Certaines scènes n'auraient ainsi pas dépareillé dans un épisode de Life on Mars.
Cependant, presque paradoxalement, si on peut lui reprocher ce côté irréel, vaguement déconnecté, c'est aussi cela qui fait de cette série une fiction policière à part. Car Whitechapel reste avant tout, plus que jamais dans cette seconde saison, un polar noir classieux, où règne une étrange intemporalité. Il y a comme un parfum diffus d'anachronisme latent, probablement recherché, qui exerce une véritable fascination. Peu importe finalement le manque de crédibilité de l'histoire. Les scénaristes ne demandent pas au téléspectateur de croire en la réalité de ce récit, mais simplement de se laisser happer par cette indéfinissable atmosphère décalée et en dehors du temps. En somme, par ses thématiques et sa narration, Whitechapel s'impose en prudente héritière des polars noirs se déroulant dans les troubles du milieu du XXe siècle. Le cadre est certes transposé de manière anachronique, mais l'attractivité du sujet demeure intacte.

Au-delà de cette question majeure relative à l'ambiance, l'autre réel point fort de Whitechapel, peut-être le plus solide, réside incontestablement dans ses personnages, ou plutôt dans la dynamique de son duo principal d'enquêteurs. Passés la rencontre et les ajustements des débuts, les voilà toujours aussi antinomiques, mais désormais beaucoup plus proches, recherchant tant bien que mal un équilibre précaire dans leur relation de travail. Ce qui a changé par rapport à la défiance de la saison 1, c'est qu'ils partagent à présent une certaine compréhension réciproque, des forces comme des faiblesses de l'autre. Si leurs clashs sont inévitables, leurs rapports n'en sont pas moins basés sur une confiance inébranlable.
Ce respect, plus ou moins perceptible suivant leurs échanges, les autorise à plus se dévoiler, conférant à leurs personnages une dimension humaine supplémentaire, plus touchante et personnelle, aux yeux du téléspectateur. Cet aspect est d'autant plus intéressant à explorer que l'affaire va les pousser dans leurs derniers retranchements, voire même au-delà. Les jumeaux Kray appartiennent à l'histoire encore récente de la ville ; et c'est à des blessures personnelles du passé que Miles va être confronté. Tandis que le DI Chandler voit son enquête peu à peu lui échapper. Ses insécurités ressortent, accompagnées des rituels qui tentent maladroitement de les contenir pour ramener une vaine illusion de contrôle. Voir ces personnages à ce point secoués et remis en cause permet de jouer efficacement sur l'empathie du téléspectateur.

Sur la forme, cette saison 2 de Whitechapel s'avère toujours aussi appliquée, consciencieusement investie dans une recherche d'esthétique propre. Si, encore une fois, on reste parfois dans le domaine de l'expérimental plus ou moins réussie, dans l'ensemble, c'est un travail de bonne facture qui est proposé. Capitalisant beaucoup sur l'atmosphère que les images peuvent générer, la série soigne sa réalisation et n'hésite pas à jouer avec les teintes de la photographie. Le rendu visuel est ainsi très agréable à l'oeil et donne une réelle classe à la série.
Enfin, le très solide casting permet de conférer une légitimité supplémentaire à Whitechapel. Rupert Penry-Jones (Cambridge Spies, Spooks) est parfait pour retranscrire toute la complexité de son personnage, entre force et faiblesse, doté une volonté de fer vaguement idéaliste emprisonnée dans des compulsions échappant à son contrôle. A ses côtés, Philip Davis (Bleak House, Collision) propose l'abrasivité adéquate pour incarner le pendant complémentaire afin d'équilibrer le duo. On retrouver également à l'affiche des valeurs sûres comme Steve Pemberton (The League of Gentlemen, Blackpool), Alex Jennings (The State Within, Cranford), ou encore Sam Stockman, George Rossi, Ben Bishop, Christopher Fulford et Peter Serafinowicz.

Bilan : A défaut de crédibilité du scénario mis en scène, cette saison 2 de Whitechapel offre une ambiance assez fascinante, quelque peu irréelle et intemporelle, qui capte le téléspectateur peut-être presque aussi efficacement qu'une histoire qui aurait été vraisemblable. La série investit avec une certaine jubilation tous les codes du polar noir, adoptant des ressorts narratifs issus d'un autre âge. Cela lui donne une étrange ambivalence, quelque peu anachronique, mais elle va assumer finalement jusqu'au bout cette spécificité tranchant avec toutes les autres fictions policières du moment. Certes on pourra aussi regretter que la série ait sans doute trop souvent tendance à céder à une relative facilité, dans ses rebondissements comme dans l'avancée de l'enquête. Pourtant, au-delà de ces maladresses ou faiblesses dont le téléspectateur est parfaitement conscient, il est difficile de ne pas être happé par Whitechapel.
NOTE : 7/10
La bande-annonce de la saison :
22:49 Publié dans (Séries britanniques) | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : itv, whitechapel, rupert penry-jones, philip davis, steve pemberton, alex jennings, sam stockman, george rossi, ben bishop, christopher fulford, peter serafinowicz | ![]() Facebook |
Facebook |
13/08/2010
(UK / Pilote) Sherlock Holmes : les classiques sont indémodables. (A Scandal in Bohemia)

Cependant, quand on évoque Sherlock Holmes à un téléphage, logiquement, le nom qui lui vient à l'esprit instinctivement, celui qui représente la personnification télévisée du détective dans bien des coeurs et des souvenirs, demeure, bien évidemment, Jeremy Brett. Il aura conquis bien des générations, dans ce qui est considéré comme probablement la meilleure adaptation au petit écran des romans de Sir Arthur Conan Doyle (nous verrons ce que l'avenir réserve à Sherlock, 3 épisodes, c'est insuffisant pour émettre un jugement).

Sherlock Holmes, c'est une série produite par Granada Television, dont la diffusion s'étendit de 1984 à 1994, sur la chaîne anglaise ITV. La maladie, puis le décès de Jeremy Brett, en 1995, interrompit la suite d'adaptations. Elle a porté à l'écran, au total, 41 des 60 aventures romancées par Arthur Conan Doyle. Elle se divise en six saisons et cinq téléfilms, portant sur quatre grandes périodes, respectivement intitulées The Adventures of Sherlock Holmes (1984-1985), The Return of Sherlock Holmes (1986-1988), The Casebook of Sherlock Holmes (1991-1993) et, enfin, The Memoirs of Sherlock Holmes (1994).
Jeremy Brett laissera une trace indélébile dans la mythologie de Sherlock Holmes, par une interprétation plus vraie que nature du détective anglais, donnant vie dans sa complexité et ses paradoxes à ce personnage qui a tant fasciné et fascine toujours autant. A ses côtés, le personnage du Docteur Watson connaîtra un changement de casting. Tout d'abord interprété par David Burke, durant The Adventures of Sherlock Holmes, ce sera ensuite Edward Hardwicke qui prendra la relève pour le reste des adaptations.

Avoir suivi, au cours des dernières semaines, la modernisation proposée par BBC1 a réveillé en moi mon éternelle fibre nostalgique toujours prompte à être réactivée au moindre prétexte. D'où, ces derniers jours, ma soudaine envie de renouer avec les classiques et de me replonger dans cette ambiance victorienne inimitable, reconstitution historique particulièrement soignée et intégrée de façon naturelle à ce récit policier. C'est ainsi que je me suis installée devant le premier épisode de la série, curieuse de revoir comment la série nous avait introduit dans son univers.
A la différence du Sherlock BBC-ien, qui opta pour une approche narrative chronologique, en ré-adaptant à l'écran, à sa manière, l'aventure marquant la première rencontre entre Sherlock Holmes et John Watson, à l'occasion de l'enquête sur Une étude en rouge (A study in Scarlet, en VO), le Sherlock Holmes ITV-ien préfère lui nous introduire directement auprès d'un duo déjà formé, à la dynamique bien huilée et aux repères posés. Peut-être pour offrir aux téléspectateurs l'opportunité d'entre-apercevoir toutes les différentes facettes de ce personnage si complexe qu'est Sherlock Holmes, ce premier épisode est une adaptation de la seule histoire, publiée en 1891 par Arthur Conan Doyle, mettant en scène une des figures féminines pourtant les plus importantes du canon Holmes-ien, Irene Adler. Il s'agit d'Un scandale en Bohème (A scandal in Bohemia).

L'épisode est tout d'abord intéressant, car, de par son statut de "pilote", c'est à lui que va incomber la tâche de nous introduire dans cette nouvelle version du canon Holmes-ien. Puisque les personnages ont déjà adopté ce quotidien routinier qui est le leur, au 221B Baker Street, la présentation à destination du téléspectateur va être amenée de façon informelle. Dans cette perspective, les premières minutes vont s'avérer particulièrement réussies. Nous y suivons le retour de Watson après plusieurs jours d'absence. Le temps de croiser Mrs Hudson et le voilà à l'étage, incertain, presque anxieux, de l'état dans lequel il va retrouver Sherlock Holmes.
Dès les premiers échanges entre eux, dialogues déjà savoureux et captant immédiatement l'essence des deux personnages, les clés principales pour comprendre le fonctionnement du duo nous sont distillées, en guise d'introduction qui ne porte pas son nom. Sherlock Holmes et son esprit brillant, si versé à sombrer dans l'ennui lorsqu'aucun mytère ne se dresse devant lui. Son penchant pour certaines drogues et autres sources d'addiction est en même temps l'occasion de montrer la haute estime qu'a pour lui (et son intelligence) un Watson que le recours à ces produits met hors de lui. Sherlock et sa profession, unique, de "consulting detective", statut qu'il s'est lui-même donné. Aucun doute, l'esprit Holmes-ien est là, instantanément, dans le petit écran.

L'histoire en elle-même est divertissante et plaisante à suivre, car elle est l'occasion d'y retrouver utilisés tous les ingrédients qui font l'identité de la série. L'héritier du trône de Boheme sollicite les services de Sherlock Holmes pour retrouver une photographie compromettante, prise aux côtés d'une jeune femme qu'il a aimée il y a quelques années, Irene Adler. Désormais fiancé à quelqu'un de rang noble, ce souvenir, conservé par son ancienne amie, donne des sueurs froides au prince, qui craint le scandale. Blessée d'avoir été éconduite, Irène lui aurait assuré qu'elle enverrait la photographie l'incriminant le jour de l'officialisation de ses fiançailles. Malgré tous ses efforts et autres effractions peu légales, l'objet demeure hors d'atteinte du fiancé qui, ne sachant plus comment s'y prendre, se tourne donc vers le célèbre détective anglais.
Au final, tout cela nous donne une aventure rythmée, qui maintient l'attention du téléspectateur tout au long de l'épisde. On y retrouve aussi avec plaisir les éléments essentiels du "canon". Des jeux de déductions, autour d'une simple lettre excessivement sybilline, jusqu'aux déguisements et autres missions "sous couverture" pour se jouer de son adversaire du jour, en passant par un sens de l'initiative et de la débrouillardise sollicité comme il se doit. Et puis, l'histoire revêt peut-être une dimension supplémentaire de par la déférence vis-à-vis du personnage d'Irene Adler, brève rencontre qui marquera profondément le détective, comme insiste dessus à plusieurs reprises Watson.

Bilan : Classique indémodable, reconstitution littéraire comme historique aboutie et entière, Sherlock Holmes est une de ces fictions sur laquelle le temps n'a que peu d'emprise, si ce n'est de façon anecdotique, en terme d'images et de réalisation. Savoureuses à suivre, les aventures mises en scène ont ce même parfum, tour à tour intrigant, piquant, qui émane des livres, porté par la fascination magnétique qu'exerce, auprès du téléspectateur, la version de Sherlock Holmes proposée par Jeremy Brett. Un classique qui se savoure sans modération.
NOTE : 9/10
Le générique (au thème musical savoureux) :
11:59 Publié dans (Pilotes UK), (Séries britanniques) | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : itv, sherlock holmes, jeremy brett, david burke, edward hardwicke | ![]() Facebook |
Facebook |



