02/11/2009
(UK) Doctor Who : une ode à l'humanisme

Armée de mon prosélytisme téléphagique toujours à l'oeuvre, je me suis employée, hier soir, à convertir un nouvel adepte à Doctor Who, en initiant un ami à la série (sous le prétexte fallacieux de tester l'écran de ma nouvelle télévision - écran qui est quand même vachement mieux que l'ancien ! soit dit en passant...). N'ayant pas la saison 1 sous la main, nous avons commencé par le premier épisode de la saison 2 -donc, directement avec David Tennant. Dans le cadre futuriste de New New York, cet épisode, sous des apparences léger, où Rose et le docteur flirtent allègrement -et plus si innocemment- dans une forme de béatitude, suite à la regénération du Docteur dans le Christmas episode précédent (entre la saison 1 et la saison 2), contient pourtant toute l'essence de la série.
Y transparaît cette ambivalence si particulière qui fait l'originalité et la force de Doctor Who, capable de toucher la sensibilité du téléspectateur avec une simplicité regénérante. L'ambiguïté de la série s'illustre en effet parfaitement à travers la double conclusion de l'épisode.
D'une part, on y retrouve retranscrit ce si fort attachement du Docteur à l'Humanité, dans lequel se mêle un optimisme enthousiaste communicatif. C'est la motivation première du personnage et quelque peu sa raison d'être qui s'expriment. L'happy end final, où il parvient à guérir tous les malades créés par les nonnes, aussi facile scénaristiquement parlant qu'il puisse paraître, se savoure pourtant devant l'écran, tel un bonheur presque naïf, mais si sincère. D'autant plus qu'il s'accompagne d'un discours euphorique du Docteur sur l'apparition d'une nouvelle sous-espèce et d'une humanité constamment en évolution.
D'autre part, la fin de Cassandra touche l'autre versant de la série, également perceptible à travers la discussion avec la Face of Boe. Celui du Temps auquel personne ne peut échapper ; de cette vie qui file et se dilue sous son emprise. L'isolement du Docteur n'en est que plus mis en exergue. Il est le "wanderer" : celui qui erre, point fixe, dans un Univers qui évolue par lui-même, en constante expansion, en incessants changements. Cette immutabilité, même si elle n'est qu'une apparence, tranche avec son environnement, rappelant incidemment au téléspectateur que même Rose, en dépit de leur relation si fusionnelle actuellement, n'y échappera pas. L'opportunité qu'il offre à Cassandra, de se revoir, une dernière fois, au temps où elle était encore elle-même, avec ses illusions, est un paradoxe temporel scénaristique, mais un geste de profonde humanité auquel le téléspectateur ne peut rester insensible.

En cherchant à expliquer pourquoi j'adorais Doctor Who, c'est à ces fondamentaux que j'en suis revenue. Ce n'est pas la rigueur qualitative d'un scénario réaliste que j'y recherche. Les esprits cyniques et blasés pourront toujours ricaner et rester de marbre devant ce ton si particulier dans le paysage téléphagique actuel. Il reste que la force de la série, c'est une spontanéité, mêlée d'une folie douce. C'est une simplicité parfois désarmante, mais dans laquelle résonne une sincérité profonde. C'est une ambivalence, entre une foi optimiste dans le genre humain et un constant rappel de ses faiblesses, avec en toile de fond, ce précepte qu'il ne faut jamais oublier : rien ne dure et l'éternité ne s'applique pas à la vie.
Voilà pourquoi j'adore Doctor Who.
La BBC a d'ailleurs annoncé il y a quelques jours une date pour le prochain épisode spécial, The Waters of Mars. Ce sera le 15 novembre. La présence de David Tennant doit être savourée. En attendant, en voici un petit extrait :
11:54 Publié dans Doctor Who | Lien permanent | Commentaires (7) | Tags : doctor who, bbc, david tennant | ![]() Facebook |
Facebook |
01/11/2009
(Mini-série UK) Cambridge Spies : l'histoire d'une trahison

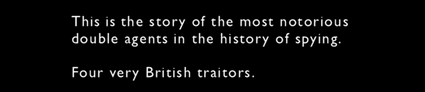
Cherchant dans ma DVDthèque l'inspiration pour le sujet de ce dimanche, je me suis arrêtée sur un classique, bien dans l'air du temps à quelques jours du retour de nos agents du MI-5 sur BBC One. Quelques années avant de travailler pour les services secrets de Sa Majesté, dans Spooks (MI-5), Rupert Penry-Jones avait déjà fait ses classes d'espion international dans une autre production de la BBC, dans laquelle il ne défendait, cette fois, pas les intérêts de la Couronne d'Angleterre.

Cambridge Spies suit leur progression et leurs désillusions sur les chemins de la trahison, de leurs études à Cambridge (l'histoire commence en 1934) jusqu'à la défection de Burgress (Tom Hollander) et Maclean (Rupert Penry-Jones) pour l'Union soviétique, en 1951, laissant Philby (Toby Stephens), le plus emblématique d'entre eux sans doute, seul encore en poste. Fortement soupçonné, ce dernier démissionnera du MI-6 quelques années plus tard. La mini-série prend le temps d'expliquer la genèse de leurs choix. Puis, ce sera l'engrenage progressif des premières missions presque anodines, confiées par les Soviétiques, jusqu'à la transmission d'informations classées, une fois les personnages en poste. Ces parties séduiront tout amateur d'histoires d'espionnage, car nous y retrouvons tous les classiques du genre jusque dans les moindres petits détails. Une manière de rappeler que réalité et fiction ne font souvent qu'un dans ces domaines et nous offrant ainsi des scènes à l'atmosphère incomparable qui pourraient être sorties tout droit des romans de John Le Carré.

Mais Cambridge Spies ne se cantonne pas seulement à ces histoires d'espions. En effet, c'est un portrait sans complaisance de la haute bourgeoisie britannique du milieu du XXe siècle qui nous est proposé. Car, en 1934, c'est dans un contexte encore bien éloigné de celui de la future guerre froide que se scelle le destin de ces jeunes gens. Issus d'un milieu privilégié, leur attirance vers un idéal aux contours de réalisation encore si mal connus, le communisme, s'explique par leurs propres observations de ce monde auquel ils sont destinés. Ce n'est pas un régime, dont ils ignorent tant, qu'ils rejoignent, mais une utopie qui n'a jamais existé. Ils réagissent d'abord confrontés à cet étouffant immobilisme ambiant, face à la rigidité d'une haute société si codifiée, tandis qu'en toile de fond, le vieux continent européen connaît la montée des fascismes dans la relative indifférence de l'Establishment britannique.



NOTE : 7/10
06:49 Publié dans (Mini-séries UK) | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : cambridge spies, bbc, rupert penry-jones, tom hollander, toby stephens, espionnage | ![]() Facebook |
Facebook |
30/10/2009
(Mini-série UK) State of Play : des jeux de pouvoir immuables
Ce soir, Arte rediffuse une des plus réussies mini-séries britanniques des années 2000 : State of Play (Jeux de pouvoir).

J'ai beau connaître l'histoire sur le bout des doigts, finir par être capable de réciter certaines scènes par coeur et avoir presque rayé mes DVD à force de visionner en boucle certaines scènes, c'est toujours un plaisir de la regarder à nouveau. Cela reste toujours aussi facile de s'enthousiasmer devant son petit écran, de jubiler devant ces dialogues finement écrits qui sonnent justes, de se prendre au jeu de cette tension qui se construit peu à peu, de se piquer aux relations entre les protagonistes qui se font et se défont, de s'interroger sur la complexité des personnages, d'applaudir devant l'ultime retournement de situation avec l'estomac noué.
C'est un thriller médiatico-politique qui s'interroge sur cette zone d'ombre trouble où évoluent les initiés du pouvoir et sur les pratiques qui y ont cours ; on plonge dans les coulisses et les rouages amers d'une démocratie, des secrets de fabrication dont nous ne sommes normalement pas témoin. Une intrigue prenante et passionnante se déroule et captive rapidement. Si bien qu'une adaptation en film a même été faite cette année par les américains. Autant le dire tout de suite, je n'ai pas réussi à trouver l'envie d'aller y risquer un oeil. C'est difficile de se motiver pour voir rejouer une intrigue simplifiée (6 heures réduites au format d'un film) et américanisée (translation géographique, mais aussi des enjeux derrière la trame principale). Mais surtout, il y a un élément, plus brise-coeur, plus répulsif : le casting original a disparu. Et imaginer State of Play sans Bill Nighy, John Simm, David Morrissey, Polly Walker, James McAvoy... C'est juste blasphématoire.

Il faut dire que State of Play et moi, cela se joue également sur un plan purement affectif. Mon premier visionnage, c'était au temps où je commençais juste à découvrir la télévision britannique. C'était au temps où je ne connaissais pas encore toutes les têtes familières du petit écran d'outre-Manche. Et ce fut juste le coup de foudre. Du genre à me conduire à aller fouiller la filmographie de tous ces acteurs, pour découvrir d'autres petits bijoux. Je garde encore les noms de John Simm (en dépit de Life on Mars) ou de David Morrissey (Blackpool, Meadowland, etc...) associés en priorité à cette mini-série. James McAvoy conservera toujours à mes yeux cette image de dandy irrésistible, en dépit de sa carrière cinématographique future. Dans mon esprit, seule Polly Walker a pu se détacher de l'image de l'épouse subissant les évènements pour devenir un symbole de Rome.
On a tous, vous comme moi, près de notre coeur de téléphage, quelques séries qui sont particulières. Ce serait trop réducteur de parler uniquement d'une question de qualité. C'est cela, certes, mais bien plus encore. Cela renvoie à l'impact que telle ou telle fiction a pu avoir sur nous lors du premier visionnage, à sa place dans notre expérience téléphagique globale. C'est purement subjectif. Souvent conjoncturel. Tellement personnel. Cela ne s'explique pas en termes rationnels. Je suis certaine que ce sentiment ne vous est pas non plus étranger. Toujours est-il que State of Play est, pour moi, une de ces fameuses séries. Une de ces éternelles et immuables qui occupent mon petit Panthéon personnel du petit écran.

Si jamais State of Play vous est encore inconnu. Je n'ai qu'un seul conseil : Arte, ce soir, 22h10 (bon, en VF, cela me hérisse un peu car il manquera quand même la savoureuse multitude d'accents offerte par la mini-série ; mais ce sera un début!). Car même si ce billet n'est pas vraiment une critique, je peux bien attribuer une note à cette série, et ce sera sans hésitation, avec tout ma subjectivité :
NOTE : 9,5/10
07:00 Publié dans (Mini-séries UK) | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : state of play, jeux de pouvoir, bbc, john simm, james mcavoy, david morrissey, bill nighy, david yates | ![]() Facebook |
Facebook |
29/10/2009
(UK) Blackadder, series 2 : Il était une fois... Hugh Laurie
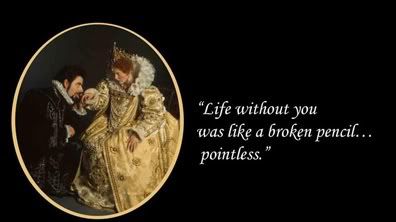
Pour occuper les monotones soirées d'automne, il y a toujours les classiques. Blackadder, véritable institution culte de la comédie britannique, est un des remèdes les plus efficaces contre ces petits moments de déprime passagère.
J'aurais sans doute l'occasion de vous parler plus en détail de cette seconde saison ultérieurement. Bien plus que la première saison, encore inachevée et hésitante sur le ton à tenir, elle consacre l'arrivée de Blackadder au panthéon des comédies britanniques. Enchaînant les épisodes réussis aux thèmes très divers, la série y trouve son équilibre ; les personnages, leur personnalité. Et les dialogues, agrémentés de répliques acides où aucun mot n'est laissé au hasard, ne peuvent laisser indifférents, délicieusement jubilatoires. Le cynisme décapant, désenchanté ou presque espiègle par moment, de Lord Blackadder, son opportunisme constant teinté de lâcheté, atteignent leur sommet dans des réparties qui font toujours mouche ; tout en trouvant un pendant parfait dans la naïveté de ce simplet de Baldrick, son serviteur, ou bien dans les frasques de son "ami", Lord Percy. Cette saison 2 se déroule à la fin du XVIe siècle, sous le règne d'Elizabeth Ier.
Outre cette consécration qualitative, la saison 2 voit l'arrivée d'un nouvel acteur en guest-star, dans les deux derniers épisodes (Beer et Chains) : Hugh Laurie. Il rejoindra ensuite le casting principal pour les deux saisons suivantes. Hier soir, quelque peu désoeuvrée, je me suis fait plaisir en regardant le dernier épisode de la saison. Hugh Laurie y incarne "l'infâme" prince Ludwig, personnage aussi machiavélique qu'absolument hilarant. Si, pour moi, Hugh Laurie restera, dans Blackadder, sans doute éternellement associé à la figure maniérée du Prince régent dans la saison 3, ces premières apparitions ne manquaient pas de piment. Il excelle dans l'art de moduler sa voix, de jouer sur des mimiques dans un théâtralisme au confinement du ridicule, déclamant avec un sérieux improbable les répliques les plus invraisemblables.
Nous sommes en février 1986, sur BBC One, soit presque deux décennies avant que Hugh Laurie ne commence à faire les beaux jours de la Fox avec House MD :



Blackadder est vraiment un classique de l'humour, indémodable à travers les années et qui se revisionne toujours avec autant de plaisir. Si jamais vous n'avez pas eu l'occasion de découvrir cette série, n'hésitez pas (elle est connue en France sous le titre de La Vipère noire). Ne serait-ce que pour découvrir certains acteurs sous un jour totalement nouveau ; et parce que c'est réducteur et tellement dommage d'avoir seulement le docteur House à l'esprit quand on pense à Hugh Laurie.
Une comédie à consommer sans modération.
Pour les nostalgiques, le générique de cette saison 2 :
12:09 Publié dans (Comédies britanniques), (Oldies - 50s-80s) | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : bbc, blackadder, la vipère noire, hugh laurie | ![]() Facebook |
Facebook |
28/10/2009
(UK) Spooks (MI-5) : One week before...
Dernier jour de repos. En famille. Je continue de griffonner quelques mots avec mon netbook... Je prends mes aises sur le blog. La peinture sèche. Je tente des expériences, comme l'ouverture d'un compte twitter. Céder à sa compulsion d'écrire sur un sujet que l'on aime, cela fait du bien aussi.
S'il y a un retour que j'attends en trépignant d'impatience derrière mon petit écran, c'est bien celui des agents secrets de Sa Majesté !

Après l'excellence d'une septième saison qui aura surclassé ses classiques inspirations et un renouvellement d'effectif parfaitement maîtrisé dans la tradition spooks-ienne, cette huitième saison s'annonce afin de résoudre le cliffhanger intenable sur laquelle la saison dernière s'était refermée. Comme toujours avec cette série (une exception dans ma pratique téléphagique toujours prompte à aller aux nouvelles, avouons-le), j'ai résolument fermé les yeux devant le moindre début d'informations potentielles, j'ai évité de cliquer sur tout sujet sensible sur les forums, j'ai détourné le regard devant les communiqués de presse de la BBC... Je ne sais rien. Je ne sais même pas s'il y a quelque chose à savoir, en fait. Me voilà donc vierge de tout spoiler. Ignorant crânement ce qui se dit dans les milieux autorisés, je suis prête à jubiler, tressaillir, mais souffrir aussi, devant ces nouvelles aventures, craignant pour la vie si fragile de ces personnages faillibles, terriblement humains dans un milieu déshumanisant. Spooks est en effet une de ces très rares séries où ce suspense macabre se retrouve trop souvent justifié.
L'échéance du 4 novembre approchant et ma mémoire, semblable à une passoire, n'ayant guère été épargnée par le passage du temps, je me suis décidée à me replonger dans cette saison 7. Hier soir, agrémenté d'une cup of tea fumante, j'ai ressorti mes DVD pour m'offrir une soirée placée sous le signe des espions de Sa Majesté. J'ai seulement revisionné les derniers épisodes, replongeant instantanément dans la tension ambiante. Il faut bien avouer que, hormis quelques images floues, la situation de fin de saison s'était évaporée dans la brume de mes souvenirs. Tout est rapidement revenu. Les Russes. La menace nucléaire sur Londres. Le sacrifice ultime de Connie, dont le prix des traîtrises se paye toujours. Et surtout, le clap de fin : Harry, enfermé dans le coffre de la voiture. Cruels scénaristes.

Tremblant pour Harry, voilà bien la crainte la plus forte que la série peut susciter.
Harry Pearce (l'excellent Peter Firth, pour lequel je suis à court de superlatifs) est l'âme de Spooks. Les crises se succèdent. Les agents de son équipe passent, se flétrissent sur le terrain, ont des fins tragiques et sont remplacés. Le service doit continuer. Et Harry demeure en son centre, point de référence qu'on finirait par imaginer immuable. Oh, ne vous méprenez pas. Je suis bien tombée sous le charme de nos héros successifs, de Tom à Lucas, en passant par Adam. A croire que ce poste au MI-5 est le rôle parfait pour se réconcilier avec un acteur, comme ce fut mon cas pour Richard Armitage (Lucas North) qui était loin de m'avoir laissé un souvenir impérissable dans Robin Hood (certes, le problème venait sans doute en bonne partie de la série). Mais au-delà de mes tendres flirts sériephilistiques, je reviens toujours à Harry. Il est le ciment de Spooks. Ses principes, son comportement, jusqu'à son élocution feutrée mais ferme (et son accent), reflètent, incarnent, l'esprit de la série.

Je serais donc au rendez-vous pour ces inédits. Prête à me morfondre en craignant la résolution du cliffhanger ; l'impatience aiguisée par le revisionnage de la très réussie saison 7 et sa fin, tellement Spooks, tellement frustrante. Alala, vivement mercredi prochain !
Spooks, Saison 8 inédite, BBC One, à partir du 4 novembre 2009.
Un bref trailer :
14:04 Publié dans Spooks (MI-5) | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : spooks, mi-5, bbc, peter firth, richard armitage, espionnage | ![]() Facebook |
Facebook |




