11/12/2010
[TV Meme] Day 17. Favorite mini series.
Déclinaison particulière au sein des productions téléphagiques, les mini-séries ont cet avantage d'allier une certaine durée - permettant des développements plus conséquents qu'un film - et une fin déjà prédéterminée qui évite généralement à l'histoire de s'étioler. Dans l'absolu, ce format offre théoriquement plus de garantie sur la maîtrise scénaristique globale. Et, de façon plus pragmatique, elle permet de s'y investir avec moins d'incertitude, en sachant déjà sur quelle durée l'on s'engage.
Pour tout un tas de raisons parmi lesquelles celles citées ci-dessus, les mini-séries sont devenues un format que j'apprécie tout particulièrement. Parce que je suis désormais naturellement portée vers des histoires qui auront une vraie fin, plus courte que les interminables marathons des grands networks US pour lesquels la lassitude me gagne désormais très vite. Cette évolution dans mes goûts est sans doute aussi un reflet indirect de ma progressive migration du petit écran américain à la télévision britannique, où ce format est plus communément admis et se rencontre fréquemment.
Le choix d'une seule mini-série s'est donc révélé à la fois compliqué, mais pourtant également très évident. Compliqué parce que la liste de ces fictions que j'admire est finalement plutôt longue, et souvent pour des raisons très différentes. Schématiquement, il y a deux chaînes qui figurent au titre de mes pourvoyeurs principaux de mini-séries : la BBC et HBO. Pour la première, c'est incontestablement State of Play (Jeux de pouvoir) qui se détache du lot. Un petit bijou de thriller médiatico-politique avec un casting de rêve et une maîtrise narrative impressionnante qui demeure un incontournable de la dernière décennie des productions anglaises. Pour la seconde, la concurrence est plus rude : John Adams, The Corner, Angels in America, Generation Kill... il y aurait des arguments recevables pour nominer chacune d'elles. Cependant, il en est une que je place encore au-dessus, dans cette zone quasi-inaccessible où l'on peut parler, sans galvauder l'expression, de chef-d'oeuvre. Une dont je vous avais reviewé un épisode l'hiver dernier en concluant sur un vertigineux 10/10 pleinement justifié (le seul de toute l'histoire du blog)...
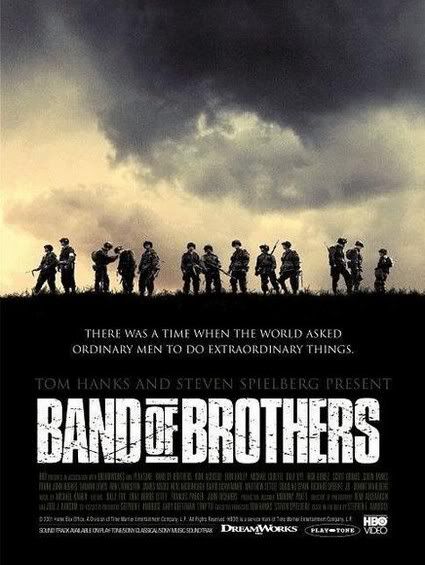
Band of Brothers
(HBO, 2001)

Band of Brothers est une de ces rares fictions pour laquelle le terme de "chef-d'oeuvre" n'est pas usurpé. Signe qui ne trompe pas, ses qualités s'imposent avec encore plus d'évidence lors d'un revisionnage tant l'ensemble apparaît solide. Le format de mini-série est d'ailleurs parfaitement adapté.
C'est un récit de guerre à la construction narrative méticuleuse, nous permettant de suivre une compagnie de parachutistes américains durant la Seconde Guerre Mondiale, du camp d'entraînement jusqu'au Nid d'Aigle d'Hitler et en Autriche. C'est une histoire d'hommes, de soldats, mais c'est bien plus que cela : au-delà de l'hommage en filigrane à leur action, c'est à ces liens qui se forment dans ces moments extrêmes où on a fait le deuil de sa vie que la série semble dédiée. La cohésion des personnages, comme l'homogénéité d'ensemble, ne peut que frapper un téléspectateur, impressionné par un récit qui ne comporte aucun temps mort, aucune baisse qualitative, mais qui présente au contraire des épisodes aboutis et complémentaires, adoptant des angles narratifs différents. Ils comportent leur lot de passages plus bouleversants les uns que les autres. Si certains épisodes sont parfois à la limite du soutenable, il n'y a aucun voyeurisme ou excès déplacés, la caméra ne se départissant jamais d'un réalisme marquant mêlé à une indéfinissable pudeur, témoin au coeur des évènements tout en sachant prendre parfois cette distance toute en retenue.
A la maîtrise scénaristique sur le fond, s'ajoute une réalisation superbe, où la photographie et l'esthétique globales sont tout simplement magnifiques pour les yeux (pour les amateurs de nouvelles technologies : j'ai revu la mini-série en blue-ray en début d'année, l'expérience fut grandiose - c'est typiquement pour ce genre de programmes que cette amélioration est pertinente), le tout accompagné d'une bande-son tout aussi sobre qu'inspirée. Enfin, le casting, choral, s'avère particulièrement convaincant, au diapason de la qualité globale, emmené par un Damian Lewis qui tient là un de ses meilleurs rôles.
Le générique inoubliable :
A relire - Ma critique de Bastogne (Episode 6) : Le chef d'oeuvre de l'enfer de Bastogne.
08:43 Publié dans (TV Meme) | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : tv meme, hbo, band of brothers, damian lewis | ![]() Facebook |
Facebook |
16/10/2010
[TV Meme] Day 9. Best scene ever.
Ce jour du TV Meme est sans doute le plus difficile à trancher. Car il existe mille et une raisons différentes de mettre en lumière des dizaines de scènes toutes aussi magistrales, s'inscrivant dans des registres différents, mais provoquant ce même ressenti de frisson devant son petit écran, accompagnant le téléphage qui a pleinement conscience d'assister à un passage particulier de sa série, au cours duquel cette dernière l'emporte encore plus loin dans le travail et le soin qu'elle accorde à sa mise en scène.
J'aurais pu choisir des scènes pour leur intensité dramatique ou émotionnelle, pour le montage et la réalisation qui les subliment... Celle sur laquelle mon choix s'est finalement arrêté s'inscrit pleinement dans un mélange de cette lignée. Elle a de plus le bénéfice de l'ancienneté. Car elle est issue de la saison 1 d'une série qui a été ma première rencontre avec le câble américaine. Elle m'a ouvert des horizons téléphagiques dont j'ignorais l'existence avant elle. (Pour l'anecdote, c'est aussi la première série que j'ai pu suivre régulièrement en VOST via des VHS (oui, c'était un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître).)

Au cours de cette première incursion, parmi tous les indices qui m'indiquaient que j'avais pénétré dans une autre dimension de la téléphagie, figurent des scènes admirables d'inspiration et de maîtrise, offrant au téléspectateur de vrais instants de jubilation devant son petit écran.
C'est notamment le cas de la scène que j'ai choisie. Elle conclut le sixième épisode de la saison 1, Pax Soprana. Dans la suite d'un grand hôtel, Junior est intronisé officiellement comme le nouveau chef de l'organisation, devant tous ses lieutenants (capi) réunis. Tony porte alors un toast à l'avènement de son oncle. Et tandis que tous les capi lèvent leur verre en l'honneur de Junior, un serveur, portant une caméra, mitraille la scène de photos qui vont attérir directement aux bureaux du FBI dont l'étau fédéral continue de se resserrer sur les mafieux, scellant ainsi, dès les débuts, la fin du nouveau règne.
Porté par une musique fascinante, ce passage est un modèle de réussite de réalisation, soulignant, par une mise en scène hautement symbolique mais sachant rester sobre, toutes les ambiguïtés inhérentes à cet évènement. L'ambivalence de cette promotion orchestrée de Junior dont la précarité témoigne de la vanité. L'ambivalence des rapports, entre liens familiaux et ambitions personnelles, qu'entretiennent Tony et Junior.
Est-ce que cette scène n'est pas magistrale ?
The Sopranos - Saison 1, Episode 6 : Pax Soprana
09:40 Publié dans (TV Meme) | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : tv meme, hbo, the sopranos | ![]() Facebook |
Facebook |
21/09/2010
(Pilote US) Boardwalk Empire : l'Amérique de la prohibition
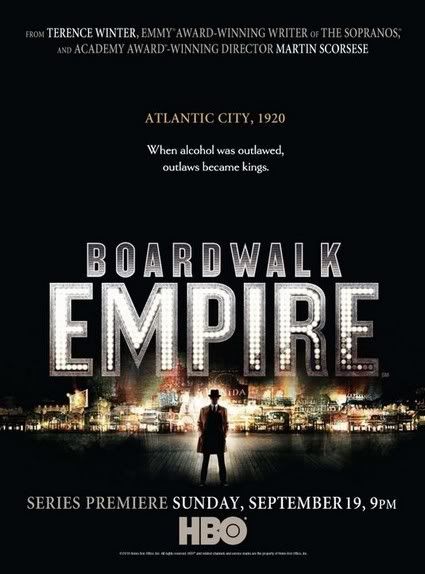
Il y a des séries dont les thématiques aiguisent d'emblée votre intérêt. D'autres dont les noms et chaîne associés au projet se chargent de retenir votre attention. Certaines, enfin, dont vous ne savez plus trop pourquoi vous vous êtes installés devant le pilote, si ce n'est cette curiosité vaguement masochiste de téléphage compulsif. Et puis, il y a des séries qui, a priori, cumulent sur le papier tous les ingrédients qui classiquement savent vous séduire : aucun doute, vous faîtes manifestement partie du public ciblé. En raison de la rareté de ces dernières, il convient de ne pas rater l'établissement du premier contact. Vous essayez donc vainement de garder vos distances avec le buzz qu'elles peuvent générer, cherchant obstinément à l'aborder vierge de tout préjugé. L'impatience grandit à mesure que la date du series premiere approche. Finalement, en dépit du bon sens et de l'équation "trop d'attente = déception", c'est avec un mélange de jubilation anticipée et d'enthousiasme que vous sacrifiez quelques heures de sommeil pour découvrir au plus tôt cette fiction.
Boardwalk Empire entrait assurément dans cette dernière catégorie. Elle était la nouveauté américaine du mois que j'attendais le plus. Voire même la seule dans laquelle j'avais vraiment envie de pouvoir m'investir. Je suppose que c'est le moment de vous parler de mes folles années lycée où, nourrissant une fascination sans borne pour le XXe siècle américain (surtout des 20s' aux 70s'), le visionnage en boucle du Parrain m'avait fait me lancer dans des lectures compulsives de tout un tas d'ouvrages sur l'histoire de la criminalité organisée. S'il serait erroné de réduire Boardwalk Empire seulement à cet aspect, disons que voir débarquer Lucky Luciano m'a rappelé des tas de souvenirs oubliés. En revanche, j'ai volontairement omis de lire le livre dont la série est tirée. Au vu du sujet, je préfère d'abord commencer par l'adaptation télévisée.

Au final, il aura fallu un peu de patience et l'entrée dans la deuxième partie de ce pilote pour que le charme de la série commence véritablement à opérer sur moi. Voici donc la première des nouvelles séries de la rentrée aux Etats-Unis pour laquelle je vais dépasser le stade du seul pilote. Une réconciliation américaine assez prévisible, mais qui en un sens rassure.
Boardwalk Empire s'ouvre en janvier 1920. L'Amérique est alors en pleine mutation, entrant dan une nouvelle ère. Les vétérans de la Première Guerre Mondiale sont de retour, les femmes obtiennent le droit de vote... et la législation instaurant la prohibition s'apprête à entrer en vigueur. Ce bannissement du commerce d'alcool hors du pays légal va faire la fortune d'un nouveau type de trafiquants. Cette redistribution des cartes s'opère également au sein d'une criminalité devant s'ajuster à de nouveaux impératifs et à des enjeux financiers croissants. C'est dans le cadre plus qu'approprié de la ville Atlantic City que la série se propose de nous faire vivre ces changements et l'entrée dans cette décennie animée des années 20.

Le pilote nous introduit auprès des différents protagonistes. Au-delà de l'impression d'une fiction chorale où il faut quelques minutes pour bien situer chaque personnage, parfois seulement très brièvement entre-aperçu, plusieurs figures se démarquent dans ce pilote. Il y a tout d'abord Nucky Thompson, homme de l'ombre incontournable du parti républicain, qui, derrière des fonctions officielles en apparence anecdotiques, tient officieusement la ville sous son contrôle, assurant sa mainmise tant sur les politiques qu'il a portés au pouvoir par le biais d'élections arrangées que sur les forces de l'ordre locales. Le personnage, assurément charismatique, rapidement fascinant à l'écran, s'impose par un style proche des gens, faussement paternaliste et maître dans l'art du compromis et de la conciliation. Il va faire d'Atlantic City une des plaques tournantes d'importation d'alcool par la mer.
Sous ses ordres durant ce pilote, Jimmy Damordy est, quant à lui, un vétéran récemment rentré aux Etats-Unis. Le jeune homme, profondément marqué par les horreurs de la guerre, a du mal à se ré-ajuster à la vie civile, d'autant que ces années passées loin de chez lui lui ont fait rater un vrai départ dans sa vie. Princeton n'est plus qu'un lointain souvenir, Nucky considère qu'il a manqué à ses devoirs en partant... Reste que Jimmy a une famille à charge et n'a pas peur de se salir les mains. Comme une nouvelle ère s'ouvre dans la criminalité, une carrière d'un autre genre semble devoir lui tendre les bras... Boardwalk Empire nous plonge dans un univers profondément masculin, où peu de figures féminines ont l'occasion de briller. Cependant la timide introduction de Margaret, épouse battue qui viendra demander de l'aide, offre de belles promesses sur cette dernière, en plus de montrer un autre versant de la gestion par Nucky de "sa" ville.

Boardwalk Empire nous immerge donc dans le tourbillon que représente Atlantic City, reflet des mutations en cours au sein de la société américaine. C'est toute une époque, avec ses paradoxes et ses atours clinquants, que ce premier épisode s'efforce de capter et retranscrire. Il se contente pour cela d'en esquisser les contours, prenant volontairement son temps, s'attachant plus à l'ambiance qu'aux intrigues immédiates. L'immersion fonctionne pleinement auprès d'un téléspectateur qui ne peut rester insensible à l'effort de reconstitution particulièrement abouti qui se dévoile sous ses yeux. L'écriture est dense, les protagonistes nombreux. Les enjeux ne sont pas forcément explicitement énoncés, l'observateur extérieur étant invité à prendre en route une histoire déjà en marche. Cependant, la narration est parfaitement maîtrisée, ne posant pas de problème de compréhension. C'est ainsi un cadre incontestablement complexe et intriguant qui est posé.
La première partie du pilote s'attache surtout à nous présenter les différents protagonistes et les moeurs courantes d'Atlantic City. Une remise en contexte faisant office d'introduction des plus intéressantes. Cependant, si elle a le mérite d'acclimater le téléspectateur, il lui manque une réelle dynamique narrative permettant de pleinement le captiver, tel un beau papier glacé dont on ne sait trop que faire. C'est à la seconde partie de l'épisode qu'est dévolu ce rôle : tout s'y accélère, les intrigues prennent un tour très concret, voire même létal. Dans la précipitation des évènements, chacun commence à se positionner, plus ou moins consciemment, sur un échiquier de pouvoirs et d'influences qui s'esquisse, remodelé par la prohibition. Cette construction résolument crescendo achève ainsi de conquérir le téléspectateur que le début avait laissé un peu sur la réserve.

Derrière les jeux de pouvoirs et les enjeux financiers, progressivement, la série intègre également de façon naturelle le cadre mafieux inévitable. Nous sommes à un tournant : la prohibition ne va pas seulement ouvrir un nouveau marché propice aux profits, elle va également faire prendre une autre dimension au crime organisé. Le choix d'Atlantic City comme cadre n'est d'ailleurs pas neutre ; chacun gardera à l'esprit que c'est dans cette ville que se déroulera, en 1929, le fameux sommet fondant le Syndicat du crime. En attendant, c'est le cheminement d'une décennie de restructuration, à travers les luttes intestines et l'émergence de nouvelles figures, que nous allons suivre. Si Nucky Thompson est une libre -mais proche- adaptation du réel Nucky Johnson, ce pilote offre cependant l'occasion de croiser des figures criminelles historiques, qui compteront durant la prohibition, de Lucky Luciano à Al Capone, en passant par Arnold Rothstein.
Boardwalk Empire n'est pas une simple série "de gangsters", mais elle s'en re-attribue habilement, à l'occasion, les codes narratifs pour délivrer sa propre version de quelques grands classiques du genre dont ce premier épisode n'est pas avare : des guets-apens se terminant en fusillade à l'assassinat d'un boss local dépassé par les mutations en cours, rien ne manque. Ce n'est pas pour rien si l'écriture a été confiée à Terence Winter, un ancien des Sopranos. Les parallèles avec d'autres oeuvres, notamment cinématographiques, s'imposent d'autant plus naturellement en raison de la réalisation.

Il faut dire que, sur la forme, HBO a mis les petits plats dans les grands et a confié la caméra à Martin Scorsese. C'est logiquement du grand standing, notamment pour capter l'atmosphère de l'époque ; cependant, il faut bien avouer que l'on n'en attendait pas moins d'une telle production. L'utilisation d'intermèdes musicaux, avec des chansons d'époque, se révèle être une bonne initiative. Un important travail se ressent devant les images. Tellement bien que l'on en viendrait presque à se demander si le réalisateur n'en fait pas un tout petit peu trop, notamment dans son recours à des montages de scènes en parallèle, sur fond musical, que ce soit celle du théâtre ou celle concluant l'épisode. La maîtrise est admirable, mais l'influence cinématographique est presque excessive dans ces scènes pourtant magistrales à l'écran, poussant au maximum la confusion des formats.
Enfin, côté casting, il n'y a rien à redire, si ce n'est saluer l'homogénité d'ensemble. Tous les acteurs sont parfaitement intégrés dans leurs rôles et délivrent de très solides performances. L'ambivalent Nucky Thompson est interprété par Steve Buscemi (dont les téléphages se souviendront sans doute dans The Sopranos pour ce qui est du petit écran). Michael Pitt interprète Jimmy Darmordy, et la superbe Kelly Macdonald (State of Play), Margaret Schroeder. Au sein de la distribution, on retrouve également Michael Shannon, Aleksa Palladino, Michael Stuhlbarg, Stephen Graham, Vincent Piazza ou encore Paz de la Huerta.

Bilan : Ambitieuse reconstitution d'une Amérique en pleine mutation au début de la prohibition, Boardwalk Empire délivre un pilote abouti. Sa construction scénaristique va crescendo après une première partie tout en exposition : cela lui permet de prendre progressivement la pleine mesure de son cadre et de ses thématiques. Reflet d'une époque et d'une ville particulière, Atlantic City, qui deviendra une plaque-tournante du trafic d'alcool, l'épisode pose efficacement ses enjeux de pouvoir et de gains, sur fond d'une criminalité également en pleine restructuration. C'est dense, prenant et impeccablement mis en scène. Tous les ingrédients se mettent ainsi efficacement en place, laissant entrevoir de belles promesses au téléspectateur. A la série de savoir faire fructifier et de concrétiser cette introduction réussie.
NOTE : 9/10
La bande-annonce de la série :
Le générique de la série :
15:51 Publié dans (Pilotes US) | Lien permanent | Commentaires (7) | Tags : hbo, boardwalk empire, steve buscemi, michael pitt, kelly macdonald, michael shannon, aleksa palladino, michael stuhlbarg, stephen graham, vincent piazza, paz de la huerta | ![]() Facebook |
Facebook |
21/08/2010
[TV Meme] Day 1. A show that should have never been canceled.

Deadwood
(2004 - 2006, HB0)

Parce que Deadwood avait réussi ce tour de force de se réapproprier en les modernisant les codes scénaristiques du western, un genre traditionnel du petit écran américain trop délaissé de nos jours.
Parce qu'elle reposait sur une galerie de personnages d'une richesse, d'une complexité et d'une intensité fascinantes, capturant comme rarement les tréfonds sombres et troubles de l'âme humaine.
Parce qu'elle a proposé, pendant trois ans, une oeuvre métaphorique passionnante sur la formation d'une nation, à la portée aussi bien historique que philosophique, en mettant en lumière cette période de transition préexistant et tendant à la constitution d'une société.
Parce qu'elle était une reconstitution d'époque, soignée et aboutie, qui méritait un arc complet.
Parce qu'elle avait su repousser les limites de l'exposition théâtralisée à la télévision et qu'elle maîtrisait cet art de la narration lente comme aucune autre.
Parce qu'elle a permis de faire découvrir au téléspectateur non-anglophone tout un champ lexical inexploré par les séries américaines (certes, peu propre à une utilisation courante).
Parce qu'un tel monument ne pouvait se conclure sur un simple et frustrant, tragiquement inachevé, "to be continued".
Parce que les deux téléfilms promis n'ont jamais été produits.
Parce que John from Cincinnati a été annulée au bout d'une seule saison.
Le générique :
16:15 Publié dans (TV Meme) | Lien permanent | Commentaires (6) | Tags : tv meme, deadwood, hbo | ![]() Facebook |
Facebook |
16/04/2010
(Pilote US) Treme : Instantané d'une ville meurtrie ou métaphore d'une renaissance ?

Down in the treme
Just me and my baby
We're all going crazy
While jamming and having fun
Trumpet bells ringing
Bass drum is swinging
As the trombone groans
And the big horn moans
And there's a saxophone
Down in the treme...

Si tout téléphage est coutumier de l'adage "l'attente génère la déception", c'était avec une impatience confiante que j'attendais Treme. C'est sans doute la seule nouveauté de la saison devant laquelle je me suis installée sans la moindre inquiétude a priori sur la qualité du show que j'allais découvrir. Certes, des noms composant une équipe créatrice n'ont jamais offert de garantie absolument certaine sur le résultat porté dans le petit écran, mais si l'âme de toutes les créations passées est conservée, alors il n'y a pas de doute à avoir. Car s'il est un fait dont je suis certaine, c'est que David Simon & Co sont capables, instinctivement, naturellement, de transposer à l'écran, avec une authenticité rare, une vraie chronique sociale au sens noble et quasi-journalistique du terme. Que cela se déroule dans les rues de Baltimore (The Corner, The Wire), d'Irak (Generation Kill) ou de la Nouvelle-Orléans, l'objectif demeure le même : recréer, ou plutôt décrire, une certaine Amérique dans un environnement particulier, par le biais d'un récit toujours profondément humain. A l'heure où les fictions pré-formatées débordent des grilles de programmes, voici le prototype opposé ; et c'est un véritable bol d'air.
Et, oui, par son seul pilote, Treme m'a conquise.

Sans scènes d'exposition ou longueurs introductives dilatoires, le pilote de Treme propose une immersion immédiate dans une Nouvelle-Orléans traumatisée, encore ébêtée, comme sonnée débout par la catastrophe qu'elle vient de connaître et dont elle commence seulement à envisager de se relever. Ses fondations-mêmes semblent atteintes, touchée jusqu'au plus profond de son âme, dans ce tourbillon de chaleur humaine auquel elle reste associée. Du déchaînement des éléments, de cette déferlante inarrêtable des eaux sur la ville, nous ne verrons aucune image directe, si ce n'est quelques rappels, souvenirs aussi fugaces qu'inutiles, finalement, tant la catastrophe demeure une ombre permanente qui pèse sur chaque mise en scène, dans toute référence directe comme au creux de ces non-dits si révélateurs dans les dialogues entre les personnages.
Ne nous faisant pas revivre ces moments où tout bascula, Treme s'ouvre ainsi quelques mois après le passage de l'ouragan Katrina. Suivant une approche familière aux téléspectateurs qui ont gardé en tête les précédentes oeuvres de l'équipe créatrice, le pilote se rapproche d'un instantané de la ville, portrait d'une cité meurtrie où le quotidien, hésitant, reprend peu à peu ses droits. Fidèle à ce format de chronique sociale, où la caméra s'efface presque pour capter une authenticité et une spontanéité des faits relatés, l'épisode offre une présentation chorale de tranches de vies, où les différents protagonistes introduits s'insèrent naturellement dans la photographie plus vaste, omni-présente, que constitue le décor de la Nouvelle-Orléans. Les scénaristes esquissent les bases des storylines, laissant le récit trouver son propre rythme.

La scène d'ouverture de la parade musicale, véritable modèle du genre, résume parfaitement l'essence de Treme. Elle est tout autant un symbole de cette expression par la musique, inaltérable, qui bat au coeur de cette ville, que les premiers signes d'une renaissance que la série nous invite à suivre. Il s'agit du premier défilé depuis Katrina. Sur un plan narratif, c'est également l'occasion d'un premier contact avec un cadre imposant, la ville en elle-même, mais aussi avec plusieurs des personnages principaux avec lesquels nous allons par la suite nous familiariser. Finalement, sont condensés dans ce défilé tous les aspects majeurs, complémentaires autant qu'indissociables, qui ressortent de ce premier épisode.
L'élément le plus marquant de ce pilote réside, en effet, dans l'effort réalisé - et réussi - pour transposer à l'écran l'âme de la Nouvelle-Orléans. L'univers coloré à l'excès de cette ville a toujours exercé une certaine forme de fascination sur l'imaginaire collectif : quelque part entre le carnaval et le jazz, c'est le côté festif que l'on retient généralement. Nombre de fictions s'y sont risquées par le passé, pour des résultats très divers, proposant invariablement des empilements plus ou moins digestes d'images d'Epinal auxquelles "The Big Easy" demeure associée dans l'esprit de chacun. D'ailleurs, en essayant de fouiller dans ma mémoire téléphagique, j'y ai trouvé assez peu d'évocations de cette ville : j'ai conservé de lointains, mais très agréables, souvenirs de Flic de mon coeur, qui restera sans doute comme la photographie sériephile de cette Nouvelle-Orléans d'avant Katrina. Dans un autre registre, Thief avait une autre ambition, mais est restée trop inconnue malheureusement. Plus récemment, K-Ville était oubliable et a été vite oubliée.

La force de Treme est de parvenir à donner vie, de façon naturelle, sans artifice ou effet de style inutiles, à une atmosphère qui renvoie pourtant parfaitement aux particularités profondément attachées à la Nouvelle-Orléans. Tout dans ce pilote respire cette cité, sans que l'on ait l'impression que l'introduction de ces multiples détails, qui sont autant d'anecdotes formant un tout homogène, paraisse forcée. Mais au-delà de cette capacité à proposer un récit humain, chronique quotidienne ordinaire aux accents pourtant spécifiques, il est impossible d'évoquer ce premier épisode sans parler de la place occupée par la musique.
Plus qu'un simple accompagnement du quotidien, c'est toute la Nouvelle-Orléans qui vit par ce rythme dansant et entraînant. Entendez-moi bien, il ne s'agit pas là d'une simple bande-son qui équivaudrait à une sélection pseudo-folklorique de morceaux "typiques" destinée à créer une "ambiance", même si Treme joue habilement sur cet aspect touristique, notamment à travers la programmation de la station de radio. Ici, ce que l'on ressent véritablement, c'est le pouls de la Nouvelle-Orléans. On perçoit, au milieu de cet univers si contrasté, entre couleurs originaires et noirceurs d'après la catastrophe, cette identité volatile qui s'exprime par le biais de la production musicale des personnages musiciens. Qu'elle vienne illustrer une renaissance, comme la scène d'ouverture, ou conclure une vie, comme le marque l'enterrement final, la musique révèle, ou marque, chaque étape du quotidien, témoignant de tout un panel si diversifié d'émotions et d'impressions.

Aussi omni-présente que soit cet aspect musical, le téléspectateur n'a jamais l'impression de se voir offrir un simple jukebox. La musique est élevée au rang d'outil de narration, utilisée par les scénaristes, pour porter à l'écran, de façon réfléchie et aussi explicitement que par les dialogues, cette chronique sociale qu'ils se proposent de nous conter. En parallèle, la dimension humaine de la série demeure donc logiquement centrale. Dans cette optique, le pilote présente toute une galerie homogène de personnages dont les tranches de vie se croisent et s'entre-choquent. Les blessures béantes laissées par Katrina n'ont pas encore commencé à cicatriser et obscurcissent tout l'horizon de Treme. Il y a bien sûr les dégâts qui sautent aux yeux du téléspectateur, ces ruines matérielles qui paraissent les plus concrètes. Mais, en arrière-plan, c'est un mal plus insidieux, plus profond, qui frappe la Nouvelle-Orléans. Ce ne sont pas seulement les maisons qui manquent, le désert que constituent certains quartiers où ne restent que des tôles froissées souligne une absence plus criante : c'est toute une population qui a été durement touchée.
Tous les habitants ne sont pas encore revenus des évacuations effectuées dans l'urgence, alors que plusieurs semaines se sont déjà écoulées depuis la catastrophe. Tous ne rentreront pas, l'eau ayant finalement balayé et tiré un trait sur un passé qu'ils souhaitent désormais laisser derrière eux. Certains ont tout perdu. D'autres reviennent sur leurs pas, retrouvant des lieux autrefois familiers où ne restent que moisissures et toitures éventrées. Chacun donne l'impression de naviguer à un peu à vue, entre fatalisme et désir ardent de tourner la page, d'aller de l'avant même si quelque chose semble irrémédiablement cassé. Si certains personnages se voient déjà attribuer un rôle bien défini, de trublion, de musicien, de victime... On devine qu'il ne s'agit que d'un premier contact, un premier aperçu de personnalités diverses, complexes, qui ne sont aussi aisément catégorisables que l'image initialement renvoyée.

S'inscrivant volontairement dans l'ombre du traumatisme causé par Katrina, l'épisode construit progressivement une communauté, des habitants dont le point commun demeure leur amour pour leur ville. Dans ce décor où certains quatiers semblent plus évoquer un pays du Tiers-Monde que les Etats-Unis, un sentiment d'isolation prédomine, renforçant un peu plus les liens entre chacun. Comme si quelque chose s'était arrêté, sur place, au passage de l'ouragan. Dans cette perspective, les scénaristes n'omettent pas de confier, à ces oubliés qui ont l'impression d'être laissé pour compte, un porte-voix pour crier toute leur frustration. Dans cette faillite complète du système qui laisse les habitants livrés à eux-mêmes, confrontés à une perte que seuls peuvent comprendre, il y a également une recherche de responsabilité. Qu'elle soit exposée de façon explicite à travers le personnage de Creighton Bernette, ou qu'il s'agisse d'un simple constat face à cette soeur qui recherche désespérément un frère qui n'a pas reparu depuis l'évacuation, la charge contre les officiels, contre les décideurs politiques, est bien réelle. Cette frustration, mêlée de désillusion, des personnages frappent le téléspectateur et ne laissent pas indifférent.

Côté acteurs, c'est l'homogénéité d'un casting au diapason de l'atmosphère de la série qui interpelle. Les personnalités s'effacent devant la caméra. Tous sont au parfaitement immergés dans l'ambiance, ils respirent naturellement l'atmosphère qui émane de Treme. Ce n'est pas très étonnant, car c'est dans l'ensemble un casting solide qui a été réuni. La plupart des personnages clés sont incarnés par des têtes plutôt familières du petit écran, à commencer par un certain nombre en provenance directe de Baltimore (The Wire et/ou The Corner), comme Wendell Pierce, Clarke Peters. Khandi Alexander retrouve sa dignité et un rôle à sa hauteur après une période d'égarement sous le soleil de Miami. Melissa Leo nous revient pour son premier rôle principal depuis Homicide. Kim Dickens continue de se construire une jolie petite filmographie (Deadwood, Friday Night Lights). Si vous avez des souvenirs téléphagiques de la décennie 90, John Goodman devrait vous dire quelque chose (Roseanne).

Bilan : Le pilote de Treme propose un véritable instantané d'une ville meurtrie, par le biais d'une mosaïque de tranches de vie qui se téléscopent, dans les mois difficiles qui suivent le passage de l'ouragan Katrina. Plus qu'une plongée immédiate au coeur du centre névralgique de la Nouvelle-Orléans, la force de cet épisode est de parvenir à capter et à porter à l'écran un portrait d'une richesse qui sonne d'une authenticité rare. Les détails de la narration jusqu'à l'instrumentalisation de la musique, omni-présente, réussissent à transposer l'atmosphère si particulière, mais obscurcie par la catastrophe, qui renvoie à l'âme-même de cette cité.
NOTE : 9/10
Le générique de la série :
Une bande-annonce de la série :
17:25 Publié dans (Pilotes US) | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : hbo, treme, wendell pierce, clarke peters, khandi alexander, melissa leo, kim dickens, john goodman | ![]() Facebook |
Facebook |



