31/03/2010
(US) Caprica, mi-saison 1 : le futur de l'humanité toujours en attente d'un vrai début

Vendredi dernier s'est terminée la diffusion de la première partie de la saison 1 de Caprica. Neuf épisodes, pour une durée bien brève venue corser un peu plus le travail des scénaristes, en leur imposant le format rigide et a-sériephile de deux mi-saisons devant être construites de façon quasi-indépendante. Cette mauvaise habitude prise par certaines chaînes de proposer une programmation qui va, par nature, contre les atouts potentiels d'un format d'une vraie saison de 20 épisodes n'a guère aidé Caprica à trouver son rythme. Au contraire. Je serais tentée de penser que cet ajout de contraintes supplémentaires a surtout entravé le développement de la série. Cela se ressent avec d'autant plus d'acuité que, disons-le franchement, cette dernière aura éprouvé quelques difficultés pour trouver ses marques, en pratiquant longtemps une forme de navigation en vue, au sein des grands éléments du scénario, sans que la cohésion d'ensemble ne prenne véritablement forme.

En effet, après neuf épisodes, le premier constat assez paradoxal qui s'impose, c'est l'étrange impression que Caprica n'a pas encore véritablement commencé. Le final du neuvième épisode et les différents évènements qu'il comporte entre-ouvrent peut-être la porte vers les vrais débuts de l'Histoire. Jusque là, la série aura usé la patience du téléspectateur attendant patiemment qu'elle embrasse pleinement le coeur de son sujet et cesse de tourner autour. Au fond, cette première partie de saison lui aura permis de maintenir son rang un prequel intrigant centré, sur un univers qui exerce son attrait sur le téléspectateur, mais nous n'aurons fait qu'entre-apercevoir un potentiel encore inexploité. Bref, ces neuf premiers épisodes ont gardé un fâcheux arrière-goût d'exposition dont la lente progression aura paru trop souvent vaine, se perdant dans des effets de style dilatoires assez frustrants au bout d'un moment.
Si bien que, sans pour autant avoir eu envie de laisser la série s'en aller sans moi, j'avoue restée très mitigée, pas pleinement convaincue des options narratives adoptées et encore plus perplexe face au traitement de certains personnages. Cela me chagrine assez car, a priori, Caprica aurait eu tout pour me plaire ; mais elle n'est pour l'instant que cette série dans laquelle je fais le choix conscient de m'investir "sur le long terme" (en espérant une saison 2, que le cocktail prenne avec le temps, et que ces idées soient enfin concrétisées !), cependant au sortir de laquelle, je suis généralement proportionnellement plus frustrée que satisfaite...

Comme je l'ai dit, le problème de cette première partie n'est pas une question de concept. Ce dernier demeure des plus solides. Mais ce sont les options prises pour le mettre en scène qui coincent. En fait, Caprica regorge de bonnes idées, qu'il s'agisse de grands thèmes généraux posés par la série ou bien d'éléments moins importants, petits détails qui aiguiseront la curiosité des plus attentifs. Leur intérêt n'est pas démenti. Pensez donc : l'intelligence artificielle, la robotique, les rapports entre réel et virtuel... tout cela ne figure pas parmi les grands classiques de la science-fiction pour rien. Ils exercent une fascination certaine et proposent un potentiel de départ aux possibilités très riches pour toute fiction envisageant de les traiter. Saupoudré l'ensemble de problématiques existentielles où pointent un soupçon de rhétorique religieuse et de thèmes plus ou moins mystiques, et vous obtenez un cocktail forcément des plus intrigants. Ajoutez à cela le fait que vous connaissez la fin de l'histoire et la tragédie qui va se prépare sous vos yeux, et vous voilà captivé. Certes, en dépit de certains questionnements communs, le résultat est très différent du penchant "space-opera", façon appel de l'espace post-apocalyptique, de la série mère, Battlestar Galactica, mais cette évolution ne surprend pas et s'impose logiquement au vu du récit envisagé.

Seulement, une fois ces problématiques posées, notamment au cours d'un pilote très correct en terme d'exposition des enjeux, Caprica passe malheureusement les huit épisodes suivants à enregistrer au ralenti les conséquences du drame initial, comme si les scénaristes craignaient de trop donner tout de suite. Si les grandes thématiques demeurent, elles paraissent ensuite presque égarées dans l'arrière-plan : maintenues dans la série de façon implicite, par les parallèles automatiques faits par un téléspectateur qui bénéficie de plus de recul et d'une vision d'ensemble lui permettant de garder à l'esprit le caractère fondamental de la genèse qui se déroule sous ses yeux. Il manque ainsi à la série la force d'une cohésion globale entre toutes ses storylines. Elle passe une trop grande partie de cette mi-saison à broder sur des intrigues à la marge, nous laissant songeur sur la manière de comprendre ces éléments anecdotiques qui relèvent plus de la contextualisation, aussi "sexy" qu'elle soit grâce l'univers proposé, celui de Caprica, aux technologies et aux moeurs à part.
Mais au-delà de cet effort, en parallèle, à une progression concrète des storylines, la série préfère user d'un recours à la symbolique, s'employant à réaliser des mises en scène à la portée particulièrement forte (ex. l'image de la Trinité évoquée avec Zoe, le caractère angélique d'une des scènes du final..). L'idée est intéressante ; seulement, encore une fois, les scénaristes ne transforment pas toujours leur essai et le téléspectateur garde l'impression désagréable qu'il y a trop de choses qui sont laissées en chantier, trop de bonnes idées juste esquissées. Il en ressort ainsi un sentiment de dispersion frustrant.

Cette impression est renforcée par le second reproche majeur que j'adresserais à la série : le traitement de ses personnages. Sans vouloir absolument aller jusqu'à ressentir de l'empathie pour ces individus touchés de plein fouet par des drames et qui se débattent au sein de cette société "futuriste" (même si le terme est littéralement anachronique dans le cas présent), beaucoup restent très difficiles à cerner, marqués par des évolutions inconsistantes, manquant de cohérence. S'il est compréhensible qu'Adama père subisse de plein fouet le deuil de sa fille, fallait-il le faire évoluer à une vitesse disproportionnée de l'homme de loi, reniant presque ses origines, à celui qui serait prêt à ordonner une exécution, puis à celui qui se perd dans New Cap City ? Si tout peut se justifier théoriquement, et apparaître a priori cohérent sur le papier, porté à l'écran, cela donne surtout l'impression d'une psychologie un peu bâclée, cédant aux poncifs du genre et construite façon girouette... Ce côté un peu brouillon, qui n'est pas propre à Adama, fait qu'il est difficile d'éprouver quoique ce soit pour des personnages dont les dilemmes sont traités au pas de charge. En terme d'évolution, les différents visages d'Amanda Graystone ont également de quoi déstabiliser, même si le couple Graystone est incontestablement l'élément le plus solide du scénario : de mère éplorée à épouse forte sortant son mari de certains bourbiers, à la régression finale vers un passé où elle avait perdu le sens de la réalité...
C'est assez paradoxal de se plaindre du ralenti excessif du développement des storylines, tout en pointant un approfondissement des personnages insuffisamment posé. En fait, toutes ces remarques soulignent surtout les difficultés qu'ont éprouvé les scénaristes pour calibrer correctement cette première partie de saison. Etait-ce dû à la brièveté des 9 épisodes ? Est-ce une période d'ajustement par laquelle ils ont dû passer pour maîtriser ensuite leur sujet ? Reste que cette écriture brouillonne donne l'impression de progresser par à-coups. Encore une fois, on perçoit toujours ce que les scénaristes avaient en tête, quel était leur projet... Mais le manque de subtilité dans l'écriture lui confère un côté très factice, qui sonne un peu faux, comme si c'était forcé. De plus, à côté, il y a également des personnages vraiment difficiles à apprécier, dont la place laisse perplexe, à l'image de Sister Clarice. Si l'idée du S.T.O., ou l'introduction globale du monothéisme soulignent l'existence de bases intéressantes, il manque un élément pour assurer la cohérence et la pleine portée...
On garde la désagréable impression que les scénaristes eux-mêmes ne savent pas trop où ils vont : dispersion et manque de cohésion semblent les reproches auxquels on se heurte dans tous les aspects du show.

Bilan : Le souci de Caprica ne provient pas d'un manque de fond ; au contraire, qu'il s'agisse des concepts généraux ou bien des petits détails de reconstitution de l'univers des colonies, on croise des tas de bonnes idées. Le problème intervient dans leur mise en scène, trop souvent inconsistante et brouillonne. Les initiatives intrigantes ne sont pas toujours transformées, les scénaristes ne vont pas toujours au bout des choses et paraissent régulièrement se disperser sans cohésion d'ensemble. Le recours aux symboles ne peut occulter le fait que la série passe ses neuf premiers épisodes sans réelle progression concrète, ponctuée par deux brusques accélérations - celle du pilote et celle du dernier épisode. Tout cela laisse un arrière-goût de profonde vanité s'installer.
En somme, Caprica a le potentiel. A elle de parvenir à dépasser cette première phase d'exposition, où elle aura effectué un certain nombre de réglages, pour pleinement concrétiser les bonnes idées que l'on voit esquissées.
NOTE : 6/10
Le générique de Caprica :
Une bande-annonce de la série :
07:23 Publié dans (Séries américaines) | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : caprica, syfy, eric stoltz, esai morales, paula malcomson, alessandra torresani, magda apanowicz, sasha roiz, polly walker | ![]() Facebook |
Facebook |
25/03/2010
(US) The Tudors, saison 4 : la dernière ligne droite de la vie de Henri VIII

Le mois d'avril prochain verra débuter, sur la chaîne câblée américaine Showtime, la quatrième et dernière saison de The Tudors. En téléphagie, il y a difficilement meilleur public que moi devant une fiction télévisée historique : peu importe l'époque, la nationalité ou même le fond du sujet, j'aime les plongées plus ou moins romancées dans un tourbillon mêlant grande et petite histoire.
Pourtant, s'il est une série historique solidement installée actuellement, mais avec laquelle j'entretiens des rapports très conflictuels, il s'agit bien de The Tudors. Pour tout vous dire, c'est une série que j'ai pris l'habitude d'abandonner, en moyenne, 3 fois par saison... mais vers laquelle je finis toujours, bon gré, mal gré, par revenir pour achever les derniers épisodes inédits et attendre la suite - ces tergiversations s'étalant généralement jusqu'à l'hiver suivant. J'ai beaucoup de peine à m'expliquer cette étrange attitude téléphagique qui défie toute logique, car cela fait quelques années que je me montre des plus expéditives avec les séries que je suis : j'abandonne sans arrière-pensée, ni regret, là où, auparavant, je m'efforçais de finir religieusement.
Objectivement, l'agacement engendré par le visionnage d'un épisode des Tudors est rarement contre-balancé par les quelques trop rares scènes bien dosées et intrigantes qu'il pourra éventuellement comprendre. Cependant, chaque printemps, je suis toujours au rendez-vous. Et chaque printemps, invariablement, après le visionnage du pré-air traditionnel, je me pose les mêmes questions qu'aujourd'hui.

Le premier qualificatif qui me vient à l'esprit en pensant à The Tudors serait le terme "frustrant". Une frustration chargée de regrets, en raison du potentiel que l'on sent poindre par moment, des moyens matériels mis à disposition et de l'ambition du sujet de départ, qui nous rappellent ce que la série aurait pu être, si d'autres choix scénaristiques avaient été faits. Elle se propose de nous raconter, romancée de manière excessive, mais surtout avec une ré-appropriation des codes scénaristiques du soap qui sont transposés, sans adaptation, dans ce cadre du XVIe siècle, la vie du roi Henri VIII, célèbre, suivant votre intérêt, pour sa politique religieuse ou le nombre d'épouses, au destin tragique pour certaines, qui se succédèrent à ses côtés. La saison 1 s'était ouverte en 1518, à l'époque Catherine d'Aragon était encore Reine d'Angleterre, le cardinal Thomas Wosley gérait d'une main de fer les affaires du Royaume et avait l'oreille du roi, et Thomas More était un ami apprécié du roi. Une éternité semble s'être écoulée tant ce tableau paraît désormais si lointain, appartenant à une autre vie bel et bien révolue. Cette saison 4 de The Tudors débute en 1740, par l'annonce du mariage entre Henri VIII et sa dernière femme en date, Katherine Howard, sa cinquième et avant-dernière.

Ce premier épisode de la saison pose les enjeux à venir, les relations amoureuses prenant, comme toujours, le pas sur le contexte historique plus global qui n'est qu'évoqué indirectement, à travers notamment les multiples références au Royaume de France. Henri VIII présente fièrement à la cour sa nouvelle épouse, une jeune femme d'une légèreté puérile ou rafraîchissante - suivant votre point de vue - , dont la frivolité exaspère rapidement le téléspectateur autant qu'elle amuse, pour le moment du moins, le roi d'Angleterre. Si les premiers pas hésitants de la jeune femme en tant que reine ne sont pas des plus concluants, elle retient surtout l'attention de Thomas Culpeper qui paraît nourrir une obsession bien malsaine à son égard, le poussant déjà aux pires extrêmités pour calmer ses pulsions. Si je n'ai porté qu'une attention très modérée à ces énièmes roucoulements soap-esques, l'épisode contient cependant des aperçus politiques plus intéressants.
L'exécution de Cromwell a laissé un vide manifeste dans l'entourage du roi, qui se contente désormais d'entériner les décisions prises quasiment seul par Henri, sans essayer, ni parvenir, à modérer les excès royaux. Assisté d'hommes ambitieux pragmatiques, à son image, il n'y a plus aux côtés du roi de conseiller sachant tirer les ficelles et s'imposer. Les quelques rares qui restent en décalage avec cette approche courtisane paraissent, de guerre lasse, ne plus se formaliser par ses éléments, tel le duc de Suffolk, un ancien toujours présent aux côtés d'Henri, mais qui a bien changé depuis sa fougue des débuts.
Pour le reste, ce début de saison reprend les mêmes ingrédients, et quasiment les mêmes schémas, que les saisons passées : de la lune de miel amoureuse - mais que l'on devine versatile - du roi, jusqu'à l'introduction d'ambitieux personnages issus de sa nouvelle belle-famille, en passant par l'instabilité de caractère d'Henri et sa constante rivalité avec la France, tout est là, de manière presque invariable. A croire que le changement d'épouse et les années qui défilent ne sont que prétexte pour reproduire les mêmes dynamiques... En cela, il est heureux que Henri VIII n'ait eu "que" six femmes et que la saison 4 soit la dernière, le risque de copier-coller commençant à poindre de manière insistante.

Les reproches que j'adresse à The Tudors n'ont pas varié depuis la première saison, si ce n'est que l'effet de répétition accentue un peu plus leur visibilité et réduit la tolérance du téléspectateur. Il s'agit d'une série qui a fait sienne le précepte selon lequel il est nécessaire ré-adapter au goût du jour ces vieux récits en costumes d'évènements d'autrefois, pour espérer ne pas offrir une plongée dans l'Histoire qui serait placée sous le signe de l'ennui. Dans cette optique, The Tudors ne propose pas une reconstitution historique : elle prend simplement le prétexte d'un tel cadre pour délivrer, avec une pointe d'exotisme passéiste prétexte à tous les excès, un soap dans les coulisses d'un pouvoir politique royal. Les histoires de coeur ont trop souvent éclipsé, voire même balayé, les enjeux politiques. La versatilité de Henri VIII n'est que la partie émergée d'une dynamique qui parcourt l'ensemble de la cour, où les sentiments - et leur dangerosité - semblent toujours destinés à prendre le pas sur des réflexions plus rationnelles. Si les scènes d'amour n'ont pas le caractère cru d'autres fictions du câble américain, conservant toujours un esthétisme soigné auquel la série est désormais attachée, elles ne manquent cependant pas, soulignées par des mises en scène généralement des plus inventives.
Seulement, cet aspect soapesque donne également une désagréable impression de creux dont la série ne parvient jamais à se départir, naviguant à vide et se perdant dans cette vanité sentimentale sans relief. Il fait malheureusement passer au second plan des intrigues politiques déterminantes, désamorçant les ressorts dramatiques, réduisant les complots politiques à des coucheries manipulatrices, le tout manquant singulièrement d'envergure. La série rabaisse ses ambitions en les réduisant à l'instinct humain le plus primaire, les sentiments, élaguant ainsi une grande partie de la complexité touchant à ses intrigues de cour. Ce n'est pas un hasard si les épisodes les plus marquants et les plus réussis proposés par The Tudors, ont été ceux qui lui donnaient l'occasion d'assumer pleinement son genre historique et permettaient de mettre entre parenthèse l'angle d'attaque soapesque choisi ; en témoigne par exemple l'épisode traitant de l'épidémie de Suette (Episode 7, saison 1), un des plus forts et des plus aboutis qu'ait eu à nous offrir la série.

Pourtant, en dépit de tous les reproches que je lui adresse, je vous l'ai dit, je finis toujours par reprendre le fil de l'histoire là où je l'avais abandonné. Pourquoi ? A bien y réfléchir, je pense que cela s'explique sans doute pour des raisons avant tout formelles. En effet, le visionnage d'un épisode de The Tudors ne peut que rappeler au téléspectateur les ambitions initiales de Showtime, soulignant les moyens investis dans cette fiction, mais réveillant aussi son lointain statut de reconstitution historique (même très romancée) qui continue d'exercer une part de fascination, en dépit de la désillusion apportée par les premières saisons. Car s'il est bien un aspect que j'ai toujours profondément admiré dans The Tudors, c'est le décor que la série a pris le soin de recréer. Au-delà de la mise en valeur des riches costumes ou des jeux de lumière avec lesquelles la caméra s'amuse, la recherche d'esthéticisme dans ses images demeure une constante particulièrement appréciable. La réalisation est appliquée, offrant de belles images retravaillées qui sont autant de tableaux paraissant tout droit sortis d'un instantané théâtral ou d'une peinture de l'époque. Pour les yeux, The Tudors constitue donc un vrai plaisir, la série sacrifiant même parfois le fond à la forme, pour mettre en valeur certaines scènes. A la manière d'une histoire couchée sur un beau papier glacé, elle impose un style très propre, renforçant ce décalage soap en offrant finalement une reconstitution visuelle idéalisée de l'époque. Cela accroît encore la distance prise par le récit avec son sujet de départ, mais il faut reconnaître que ce choix esthétique, dans lequel même certaines exécutions, par leur façon d'être filmées, peuvent apparaître comme des oeuvres d'art, sait exercer et entretenir une certaine fascination sur le téléspectateur.

Bilan : Bénéficiant d'un cadre historique prétexte à une reconstitution soap-esque qui place les sentiments au coeur de la dynamique du récit, The Tudors souffre d'un certain manque d'envergure et de relief. Derrière la belle façade très chatoyante, les histoires, au final des cycles assez répétitifs, tournent quelque peu à vide. Les enjeux des intrigues s'effacent derrière la versatilité et à l'intensité émotionnelles mises en scène. L'emballage apparaît avoir été trop souvent préféré à la richesse du contenu, alors même que le sujet aurait pu se prêter à un récit des plus passionnants.
Ainsi, si je regarderai probablement l'intégrale de la série, je dois bien avouer que celle-ci m'aura toujours laissé plus de regrets que de satisfactions.
NOTE : 5/10
Le long trailer introduisant cette dernière saison :
Le générique de cette quatrième saison à venir :
08:09 Publié dans (Séries américaines) | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : showtime, the tudors, jonathan rhys meyer, henry cavill | ![]() Facebook |
Facebook |
13/03/2010
(US) White Collar, saison 1 : En un mot, "charmant"

Mardi soir s'est achevée la première saison, comportant 14 épisodes, du nouveau hit de USA Network, White Collar. Souvenez-vous, le test du pilote constituait une des premières notes de ce blog : White Collar : Charm me if you can !. Finalement, à la différence de la majeure partie des nouveautés de cette saison 2009-2010, je suis bel et bien restée devant cette fiction, estampillée "divertissement et détente", jusqu'au bout de la saison. Et, à des périodes où j'étais tombée au seuil téléphagique critique de seulement 3 ou 4 série américaines suivies par semaine, j'avoue même avoir pris pas mal de plaisir à suivre ces pseudos enquêtes et la dynamique plaisante qui règne dans cette série, portée par un duo d'acteurs à l'alchimie évidente à l'écran.

White Collar, c'est le type de production parfait à caser après une journée de boulot, un petit bol d'air frais revigorant dans le paysage téléphagique. Parmi les petits plus qui font de la série ce qu'elle est, il faut tout d'abord saluer la tonalité qui se dégage de l'ensemble. Elle est en effet dotée de dialogues bien ciselés, agrémentés de petites piques qui font souvent mouche et d'une capacité à verser dans le second degré, dès que cela nécessaire, rafraîchissant et qui met instantanément le téléspectateur à l'aise. Si bien que ce show se construit très rapidement un joli capital sympathie, qu'il va ensuite s'efforcer de cultiver, avec beaucoup de soin et une certaine réussite, tout au long de la saison. Jouant sur une forme de bonne humeur générale contagieuse, l'atmosphère globale bénéficie pleinement de cette légèreté bien calibrée. L'ambiance parvient, presque sans effort apparent, à fidéliser le téléspectateur, bien aidée par l'autre grand atout de la série, qui réside dans sa dimension humaine.

S'inscrivant dans la droite lignée des autres fictions phares de la chaîne USA Network, White Collar choisit en effet de donner la priorité à ses personnages. Cela a pour conséquence plus discutable de reléguer au second plan les enquêtes, qui apparaissent souvent comme une sorte de toile de fond, servant plus de faire-valoir et de prétexte afin de mettre en avant les dynamiques existant entre les différents personnages. Plus que tout, la série trouve sa raison d'être dans le sacré numéro de duettistes offert par les deux protagonistes principaux : est mise en scène une relation virevoltante et fluctuante, basée initialement sur un certain respect des capacités "professionnelles" de chacun, mais qui devient progressivement synonyme d'une amitié atypique, où la question récurrente reste celle de la confiance.
Peter, l'agent du FBI, et Neal, l'escroc détenu avec qui il a conclu ce partenariat de travail, jouent sur une classique dynamique du petit écran : l'association des opposés. Mais aussi traditionnelle que cela puisse paraître a priori, il se dégage de leur paire, de façon assez étonnante, une complicité authentique, parfois malicieuse, parfois très sérieuse, particulièrement rafraîchissante. Elle constitue l'âme de la série. Car c'est sur ces personnages, attachants et sympathiques, que White Collar mise pour séduire le téléspectateur et le convaincre de rester. C'est en effet par l'angle de l'affectif que la série va s'imposer comme incontournable dans l'agenda du téléphage : un divertissement, certes sans prétention, mais diablement charmant.

Au-delà de la dynamique plaisante instaurée entre nos deux héros, si agréable à suivre, White Collar ne serait pas White Collar sans ses acteurs. Car elle est l'illustration à succès d'une série construite par et sur son casting principal, bien équilibré et choisi. L'alchimie existante entre Peter et Neal n'émane pas seulement du script ; Tim DeKay (Carnivàle) et Matt Bomer (Tru Calling, Chuck) ont une complicité instinctive à l'écran qui permet justement de jouer, avec beaucoup de naturel, sur cet aspect. Dans ces séries où la dimension humaine est déterminante, c'est un élément clé. Or, les deux ont parfaitement intégré les différentes facettes de leurs personnages respectifs, et la dynamique qui se dégagent de leurs intéractions devient rapidement contagieuse.
De plus, je l'avoue, depuis le temps que j'espérais secrètement que Matt Bomer décroche un rôle principal dans une série dans laquelle je pourrais m'investir (ses précédents essais ne m'avaient jamais vraiment emballé), je pouvais rarement rêver meilleure occasion, tant le personnage Neal est juste parfaitement adéquat pour son jeu d'acteur et lui correspond naturellement (même si, certes, je ne prétends pas faire preuve d'une grande objectivité dans mes jugements le concernant).

Reste que si cette saison 1 aura été très plaisante à suivre, il faut cependant reconnaître que la série marche à l'affectif, n'offrant pas toujours des storylines à la hauteur de ce jeu relationnel qu'elle sait si bien mettre en scène. Après un premier épisode d'ouverture convaincant, la suite sera d'une qualité plus fluctuante, alternant entre enquêtes trop convenues d'un classicisme extrême et affaires un peu bancales, à la cohérence parfois un brin douteuse, sur lesquelles il ne faut pas trop s'attarder. Le FBI ressemblera plus d'une fois plus à une agence de détective privé qu'à une organisation fédérale... Dans la deuxième partie de la saison, les scénaristes commenceront à utiliser un peu plus le passé de Neal, ramenant à plusieurs reprises des adversaires ou connaissances opérant de l'autre côté de la barrière de la loi, pour des confrontations qui suivent un schéma invariable qui devient un peu répétitif. De plus, le supposé fil rouge construit tout au long de la saison ne brille pas par l'intérêt qu'il suscite chez le téléspectateur : tournant autour d'une mystérieuse Kate, pour laquelle on peine à comprendre l'obsession que Neal éprouve, elle amènera surtout des micro-enjeux (la boîte à musique), quelques faux retournement de situations (le cliffhanger de mi-saison) et une conclusion explosive qui constitue un cliffhanger comme un autre. Rien de bien transcendant.
Ainsi, si elles se suivent pourtant sans s'ennuyer, avec un rythme toujours entraînant, ces storylines ne marquent pas vraiment, permettant avant tout aux personnages - et surtout à Neal - de faire le show ; mais ce, avouons-le, pour le plus grand plaisir du téléspectateur.

Bilan : White Collar s'est révélé être un divertissement charmant et plaisant. L'atout de la série est d'être parvenue à exploiter, avec une fraîcheur étonnante et beaucoup de légèreté, la dynamique pourtant classique de l'association entre deux personnages que tout oppose a priori. C'est agréable, honnête, et cela se suit sans arrière-pensée. Au final, voici donc une fiction où l'affectif joue un rôle déterminant et dont l'attrait repose principalement sur ses personnages attachants et son casting des plus convaincants. Mais ces différents ingrédients prennent très bien ; et le mélange tient ses promesses !
Pour ma part, c'est un peu typiquement le genre de série pour lequel j'ai souvent une tolérance d'environ deux/trois saisons, avant de passer à autre chose (jurisprudence Psych et Burn Notice, notamment, sur la même chaîne). Mais, pendant l'intervalle, je vais prendre beaucoup de plaisir, grâce à l'ambiance générale qui y règne. Et je serai au rendez-vous pour la saison 2, dès cet été.
Pour le moment, je savoure donc. Et puis, vous ai-je dit combien j'appréciais Matt Bomer ?
NOTE : 7/10
Une vue globale sur la série :
Le rendez-vous pris pour la saison 2, avec spoilers du finale de la saison 1 :
18:17 Publié dans (Séries américaines) | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : usa network, white collar, matt bomer, tim dekay | ![]() Facebook |
Facebook |
09/03/2010
(US) Southland, saison 2 : sobre chronique humaine du quotidien de policiers à L.A.

La semaine dernière débutait la seconde saison de Southland. Nous avions quitté nos policiers de Los Angeles au printemps dernier sur NBC, en croisant les doigts pour que ce grand network, peu réputé dernièrement pour ses politiques téléphagiques, veuille bien consentir à octroyer quelques épisodes supplémentaires à une série dont le potentiel était manifeste. Dans un étrange éclair de lucidité passager, elle renouvelait initialement Southland, commandant 13 nouveaux épisodes. Mais l'automne revenant, soudain, la série ne parut plus à sa place dans la grille des programmes de sa chaîne. Six épisodes étaient déjà dans la boîte. Nouveaux atermoiements. Timidement, une chaîne câblée se manifesta : TNT. Après avoir été mise à mort sans diffusion, Southland se voyait ressuscitée sous perfusion : un sursis de six épisodes lui était octroyé, juste de quoi diffuser les épisodes déjà tournés. C'est déjà ça.
Ainsi donc, c'est sur TNT que le téléspectateur retrouvait Southland mardi soir dernier. Cette création de John Wells (nom resté associé à Urgences et New York 911) n'offrira pas l'occasion de me réconcilier avec NBC.

Southland choisit de nous faire partager le quotidien de policiers de Los Angeles, situés à plusieurs échelons, dans leur journée rythmée par la violence ordinaire, entre interpellations de suspects, querelles de voisinage, fusillades et autres crimes de sang. Cet angle diversifié permet à chaque épisode de bénéficier de plusieurs intrigues, traitées en parallèle, qui peuvent rester indépendantes, mais sont aussi parfois amenées à se recouper. L'intérêt de ce schéma narratif, c'est d'offrir ainsi l'occasion de s'intéresser à la dynamique des rapports existant au sein de plusieurs duos de partenaires. Nous nous situons au bas de la hiérarchie, mais à divers degrés.
Le duo le plus symbolique de la série, qui a marqué la première saison, reste l'association de l'apprenti flic, encore stagiaire, Ben Sherman (un Ben McKenzie qui m'a plutôt convaincue, après Newport Beach) avec son instructeur, John Cooper (Michael Cudlitz, croisé dans Standoff et Band of Brothers notamment), en officiers patrouillant leur secteur dans leur voiture de police. Optant de réellement s'investir dans leurs personnages, au fil des épisodes, les scénaristes révèlent peu à peu des personnalités à multiples facettes, bien plus complexes que l'on aurait pu imaginer de prime abord. Chacun balaye de nombreuses idées reçues, qu'il s'agisse des origines sociales de Ben Sherman ou des secrets de John Cooper. Initialement presque improbable, leur paire fonctionne finalement très bien, jouant sur le ressort classique ancien/nouveau. Plusieurs autres personnages gravitent dans l'équipe des patrouilleurs, incompétents notoires, policiers marchant sur une corde raide ou bien, simple agent faisant leur boulot. Il y a comme une réminescence de New York 911 qui règne, et ce n'est pas pour me déplaire.

En parallèle, Southland choisit de se concentrer sur le service des homicides, permettant ainsi de suivre l'intégralité des enquêtes au côté des inspecteurs. Sur le même schéma que pour les patrouilleurs, c'est à nouveau sur les associations entre partenaires que la série se concentre, avec deux duos de détectives distincts. Il y a, d'une part, les très professionnels et efficaces Lydia Adams (Regina King) et Russell Clarke (Tom Everett Scott, vu dans Saved ou encore The Street), avec leur complicité presque naturelle, personnages posés et réfléchis qui apportent leur expérience et une intuition instinctive souvent bien inspirée sur les scènes de crimes. D'autre part, nous avons deux autres collègues, plus portés à parfois trop en faire, Nate Moretta (Kevin Alejandro, croisé dans Shark ou encore Ugly Betty) et Sammy Bryant (Shawn Hatosy). Un peu moins mis en avant, ils héritent de storylines plus classiques.
L'attrait de Southland, c'est de sincèrement essayer de mettre en avant ses personnages, à travers leur vie professionnelle, par les enquêtes policières, mais pas seulement, s'intéressant aussi par intermittence à leur vie privée. La série ne dispose pas de personnages s'imposant comme sortant du lot et pouvant se présenter comme atypique. Cette absence de surenchère traduit une volonté de sobriété qui fait aussi la force de ce portrait qu'elle dresse : en dépit du cadre, sur fond de guerre des gangs à Los Angeles, il n'y a rien de la noirceur d'un The Shield, seulement une volonté de présenter un quotidien, presque monotone, mais qui n'est pas dépourvu d'accents réalistes. Sans apporter de nouveauté à ce genre de fiction, Southland s'inscrit honnêtement dans une tradition sous-représentée à la télévision américaine actuellement.


Le season premiere, diffusé mardi dernier, a lancé la saison de la plus convaincante des manières, choisissant de traiter directement des conséquences des évènements de la fin de saison passée, sans s'arrêter sur leur découverte. Parmi les officiers de patrouille, Chickie Brown subit la mise à l'écart de ses collègues, suite à sa gestion des problèmes de dépendance de son partenaire. Elle se retrouve associée à un policier incompétent, incapable de faire son job, mais qui peut surtout se révéler dangereux sur le terrain. Ben Sherman entre lui dans la dernière phase de son stage. Du côté des détectives, sévèrement blessé dans le season finale, Russell Clarke n'a toujours pas quitté l'hôpital et se remet difficilement, avec une longue convalescence devant lui. Si Lydia n'oublie pas son partenaire, les doutes sur sa santé amènent un nouveau venu à devoir faire équipe avec la jeune femme. Ambitieux, assez hautain, mais également pragmatique, l'association commence par faire des étincelles. Le quotidien des patrouilleurs et des inspecteurs va se croiser, confrontés à la disparition d'un vieil homme. En parallèle, Moretta et Bryant tournent autour d'un dangereux trafiquant, auquel ils lient le mort de la dernière enquête qu'ils ont récupérée. Pour cela, ils se rapprochent d'une force d'intervention, une coopération entre différents services, destinée à le faire tomber.

Bilan : Southland n'est pas parfaite, pourtant, le potentiel perçu donne incontestablement envie de s'investir dans cette série qui est, en quelques épisodes à la diffusion hasardeuse, parvenue à se créer un univers propre et clairement identifié. Construite sur les bases et avec les ficelles scénaristiques d'un cop-show classique, elle prend toute sa dimension lorsqu'elle laisse libre cours à sa dimension humaine. Le petit écran, croulant sous les formula-show aseptisés, manque cruellement de ces chroniques du quotidien qui ont marqué les dernières décennies. C'est aussi pour cela que Southland attire l'attention : c'est une petite bouffée d'air frais qui remplit, sans prétention, une case actuellement un peu oubliée par les chaînes américaines.
NOTE : 7/10
Vidéo promo diffusée par TNT pour la saison 2 :
07:59 Publié dans (Séries américaines) | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : tnt, nbc, southland, ben mckenzie, michael cudlitz, regina king, tom everett scott, kevin alejandro, shawn hatosy | ![]() Facebook |
Facebook |
27/02/2010
(US) The Black Donnellys : Family above all
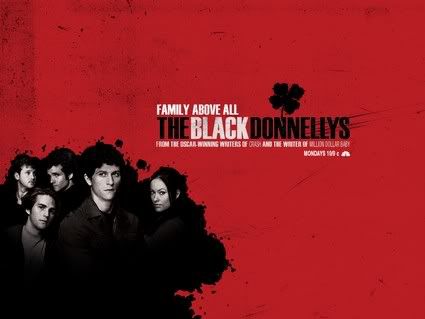
Parfois, la téléphagie nous conduit sur des chemins quelque peu masochistes. Se replonger dans des productions qui n'ont pas été entièrement diffusées, qui ont été conduites au cimetière des séries en moins de temps qu'il ne faut pour les laisser s'installer dans une case horaire, voilà le côté sombre du quotidien du sériephile. Car le coeur du téléphage ne suit pas toujours - loin s'en faut - les dures réalités des audiences. Combien de coups de coeur pour des fictions si vite annulées qu'il ne reste plus qu'à se tourner vers les DVD, en jouant de façon compulsive avec sa télécommande, afin de se remémorer quelques bons souvenirs et tout un ensemble de potentialités sacrifiées sur l'autel de l'audimat ?
Parmi mes plus grands crève-coeurs de ses dernières années figurent une brève série de NBC, petite incursion rafraîchissante et prenante de l'autre côté de la barrière de la loi, qui aurait mérité bien mieux : The Black Donnellys. Diffusée au printemps 2007, la série subit un enterrement de première classe (son annulation était plus ou moins déjà pressentie avant même la diffusion), qui me chagrina au plus haut au point. Ce fut mon plus grand regret de la saison 2006-2007. A l'époque, je n'avais eu le courage que de regarder quelques épisodes, puis je préférais passer à autre chose avant de trop m'attacher. Mais, il y a quelques semaines, je suis tombée sur le coffret DVD de l'intégrale de la série - soit 13 épisodes - à un prix très raisonnable. Le temps ayant adouci - mais sans la faire disparaître entièrement - l'amertume de son annulation, je saisissais sans arrière-pensée cette opportunité de découvrir (enfin) intégralement cette fiction. Depuis, mes regrets sont revenus, mais je ne regrette pas d'avoir pris le temps de savourer ces 13 épisodes.

Créée par Paul Haggis et Robert Moresco, The Black Donnellys raconte l'histoire de quatre frères, d'origine irlandaise, qui vivent dans un quartier populaire de New York, Hell's Kitchen. Habitués des petits larcins, les circonstances vont peu à peu les entraîner dans de dangereuses intrigues touchant au crime organisé. Essayant de survivre tout en se retrouvant embarquer dans des histoires qui les dépassent parfois, leur priorité va demeurer la même au fil des épreuves : rester unis et se protéger les uns les autres. En guise d'anecdote, il faut préciser que si la série se déroule dans le présent, son titre fait cependant référence à un fait divers célèbre de la fin du XIXe siècle. Dans l'Ontario canadien, les vrais "Black Donnellys" connurent un destin funeste en 1880, où cinq membres de la famille furent massacrés au cours de représailles.
Le casting se révèle homogène et plutôt convaincant. Les quatre frères sont incarnés par des acteurs qui avaient surtout été cantonnés à des rôles de guest-stars auparavant. Le téléspectateur les découvre donc en grande partie en même temps que la série. Ils parviennent très bien à mettre en valeur tant leurs différences que ce lien indestructible qui les unit. Jonathan Tucker (Tommy) est plus ou moins leur leader, doté d'un sens des responsabilités très développé ; Tom Guiry (Jimmy), celui qui verse dans les drogues et les intrigues dangereuses ; Billy Lush (Kevin) (Generation Kill), l'as pour s'attirer des ennuis, avec un côté débrouillard, mais loser, qui le lâche pas ; et, enfin, Michael Stahl-David (Sean), le plus jeune frère, apprenti play-boy plus en retrait. A leurs côtés, Olivia Wilde (House MD) représente l'intérêt amoureux, amie de toujours de la famille. Parmi les autres têtes connues, on retrouve notamment Kirk Acevedo (Oz, Band of Brothers, Fringe) qui joue le chef local de la mafia italienne. Enfin, Keith Nobbs est le narrateur extérieur de l'histoire, un ami des frères qui raconte, a posteriori, du fond de sa cellule, l'engrenage criminel dans lequel les Donnellys ont été pris.

The Black Donnellys se place habilement à la croisée des genres, entre histoires de famille, instants d'insouciance très légers et drames pesants, où la réalité se heurte, parfois de façon très cruelle, aux rêves et projets de chacun des personnages. C'est une série de gangsters, nous immergeant dans les eaux troubles du crime organisé. Cependant, elle s'inscrit dans une tradition narrative plutôt "old school". En effet, même si elle est sensée se passer en 2005, l'ambiance de quartier qu'elle décrit évoque plus le début des années 90. Pour autant, et peut-être grâce à cela, le téléspectateur n'a aucune peine à se laisser entraîner dans ce récit au dynamisme contagieux.
Sa richesse réside dans l'intensité des relations humaines mises en scène, qui s'imposent rapidement comme le véritable coeur de cette fiction. En effet, si les intrigues, plus ou moins criminelles, sont parfaitement intégrées et se révèlent très solides, rythmant énergiquement la narration, l'ambiance repose surtout sur les personnalités très diverses des personnages et sur leurs intéractions. Il se dégage de l'ensemble une indéfinissable fraîcheur et une spontanéité très appréciable pour le téléspectateur, qui manifeste un attachement quasi-immédiat pour cet univers haut en couleurs, entre faux roman noir et vrai drame mettant en avant une humanité avec ses forces et ses travers.
L'exposé des relations intenses, tout aussi fusionnelles que conflictuelles, qui existent entre les frères, constitue incontestablement un des points forts, très accrocheurs, de la série. Souvent extrêmes, jamais unidimensionnelles, ni manichéennes, on y retrouve une explosivité, mais aussi une authenticité, vraiment prenante. Les très fortes personnalités de chacun permettent de donner du relief à leurs rapports, que rythment les ennuis qu'ils attirent invariablement.

Au final, même si elle n'était peut-être pas faite pour un public de grands networks (toutes les productions n'ont pas la chance de Southland), la série se joue pourtant admirablement bien des contraintes que son exposition lui impose. En effet, elle parvient à nous plonger, d'une façon qui sonne très juste et réelle, dans le milieu du crime organisé new-yorkais, au sein d'un quartier où Irlandais et Italiens se disputent le leadership. Elle n'hésite pas à mettre en scène des scènes de violence ponctuées de drames, sans pour autant se départir d'une forme de dynamisme coloré qui alterne les tonalités. Plus que le fond du récit, c'est la manière dont il nous est raconté qui fait son originalité. Nous sommes loin d'une atmosphère contemplative que l'on retrouve dans les séries du câble, où les scénaristes prennent leur temps, telles Brotherhood ou les Sopranos, avec lesquelles le téléspectateur aurait tendance instinctivement à la comparer au vu de son synopsis.
Dans The Black Donnellys, tout est très rythmé. Famille et crime s'imbriquent presque naturellement à l'écran, chaque volet du récit servant et légitimant le traitement de l'autre. En ce sens, la série bénéficie d'une narration très aboutie, qui est instantanément en place dès le pilote. Le choix de faire intervenir un narrateur extérieur qui nous relate, a posteriori, l'engrenage dans lequel les frères Donnellys se sont laissés embarquer, se révèle être une bonne idée. Il permet de prendre un certain recul par rapport aux évènements racontés et de se ménager quelques effets de style pour alléger l'atmosphère quand elle devient trop pesante. Cela donne aussi initialement l'impression au téléspectateur qu'il s'agit d'une histoire qui s'est achevée : qu'il assiste à un enchaînement de faits qui a conduit les frères sur une pente dangereuse qui se termine en impasse.
Pour autant, l'annulation trop précoce de la série entraîne logiquement une absence de fin véritable. Elle ne laissera au téléspectateur que le loisir de spéculer sur une éventuelle conclusion, à partir notamment de diverses allusions cryptiques faites par le narrateur ou ses interrogateurs, sans que l'on sache à qui ou à quoi ils font vraiment référence. Une certitude : la route des Donnellys fut pavée de drames et de morts violentes, mais chacun est libre, au final, de prendre le parti qu'il souhaite. La scène finale nous laisse en pleine action, sur un suspense intense, tout en pouvant aussi constituer une forme de fin très ouverte.

Bilan : The Black Donnellys fut une série mêlant les genres, mais aussi les tonalités sombres ou légères, de façon très habile. Les liens familiaux et intrigues criminelles s'imbriquent avec beaucoup de naturel et d'authenticité. Dotée d'un dynamisme contagieux, bénéficiant de personnages forts qui s'imposent instantanément à l'écran, elle exploite efficacement une narration assez ambitieuse et très aboutie. En conséquence, si je ne devais vous donner qu'un seul conseil : ne passez pas à côté d'un tel petit bijou par crainte d'une absence de réelle conclusion, vous ne regretterez pas la découverte !
Au fond, en dépit de ce que je râle souvent, je crois que mon problème, ce n'est pas tant que je n'aime pas les séries des grands networks US. C'est juste que toutes celles dans lesquelles j'aurais vraiment aimé m'investir sont si rapidement annulées qu'on oublie en quelques semaines jusqu'au fait qu'elles aient un jour existé... Tiens, prochainement, il faudra que je vous parle de Kings, par exemple.
NOTE : 9/10
Une brève promo diffusée par NBC :
Une bande-annonce plus longue qui expose les évènements du pilote :
10:55 Publié dans (Séries américaines) | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : nbc, the black donnellys, jonathan tucker, tom guiry, billy lush, michael stahl-david, olivia wilde, kirk acevedo | ![]() Facebook |
Facebook |



