21/09/2010
(Pilote US) Boardwalk Empire : l'Amérique de la prohibition
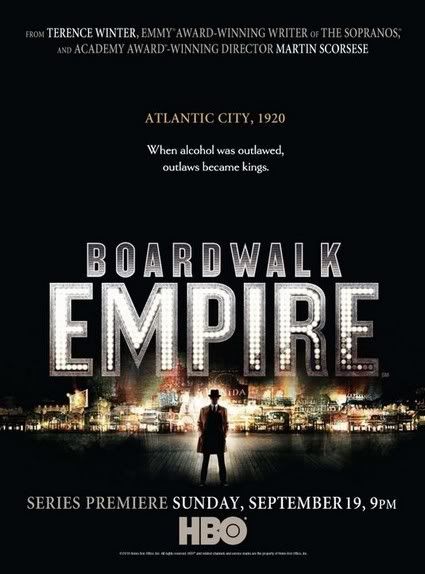
Il y a des séries dont les thématiques aiguisent d'emblée votre intérêt. D'autres dont les noms et chaîne associés au projet se chargent de retenir votre attention. Certaines, enfin, dont vous ne savez plus trop pourquoi vous vous êtes installés devant le pilote, si ce n'est cette curiosité vaguement masochiste de téléphage compulsif. Et puis, il y a des séries qui, a priori, cumulent sur le papier tous les ingrédients qui classiquement savent vous séduire : aucun doute, vous faîtes manifestement partie du public ciblé. En raison de la rareté de ces dernières, il convient de ne pas rater l'établissement du premier contact. Vous essayez donc vainement de garder vos distances avec le buzz qu'elles peuvent générer, cherchant obstinément à l'aborder vierge de tout préjugé. L'impatience grandit à mesure que la date du series premiere approche. Finalement, en dépit du bon sens et de l'équation "trop d'attente = déception", c'est avec un mélange de jubilation anticipée et d'enthousiasme que vous sacrifiez quelques heures de sommeil pour découvrir au plus tôt cette fiction.
Boardwalk Empire entrait assurément dans cette dernière catégorie. Elle était la nouveauté américaine du mois que j'attendais le plus. Voire même la seule dans laquelle j'avais vraiment envie de pouvoir m'investir. Je suppose que c'est le moment de vous parler de mes folles années lycée où, nourrissant une fascination sans borne pour le XXe siècle américain (surtout des 20s' aux 70s'), le visionnage en boucle du Parrain m'avait fait me lancer dans des lectures compulsives de tout un tas d'ouvrages sur l'histoire de la criminalité organisée. S'il serait erroné de réduire Boardwalk Empire seulement à cet aspect, disons que voir débarquer Lucky Luciano m'a rappelé des tas de souvenirs oubliés. En revanche, j'ai volontairement omis de lire le livre dont la série est tirée. Au vu du sujet, je préfère d'abord commencer par l'adaptation télévisée.

Au final, il aura fallu un peu de patience et l'entrée dans la deuxième partie de ce pilote pour que le charme de la série commence véritablement à opérer sur moi. Voici donc la première des nouvelles séries de la rentrée aux Etats-Unis pour laquelle je vais dépasser le stade du seul pilote. Une réconciliation américaine assez prévisible, mais qui en un sens rassure.
Boardwalk Empire s'ouvre en janvier 1920. L'Amérique est alors en pleine mutation, entrant dan une nouvelle ère. Les vétérans de la Première Guerre Mondiale sont de retour, les femmes obtiennent le droit de vote... et la législation instaurant la prohibition s'apprête à entrer en vigueur. Ce bannissement du commerce d'alcool hors du pays légal va faire la fortune d'un nouveau type de trafiquants. Cette redistribution des cartes s'opère également au sein d'une criminalité devant s'ajuster à de nouveaux impératifs et à des enjeux financiers croissants. C'est dans le cadre plus qu'approprié de la ville Atlantic City que la série se propose de nous faire vivre ces changements et l'entrée dans cette décennie animée des années 20.

Le pilote nous introduit auprès des différents protagonistes. Au-delà de l'impression d'une fiction chorale où il faut quelques minutes pour bien situer chaque personnage, parfois seulement très brièvement entre-aperçu, plusieurs figures se démarquent dans ce pilote. Il y a tout d'abord Nucky Thompson, homme de l'ombre incontournable du parti républicain, qui, derrière des fonctions officielles en apparence anecdotiques, tient officieusement la ville sous son contrôle, assurant sa mainmise tant sur les politiques qu'il a portés au pouvoir par le biais d'élections arrangées que sur les forces de l'ordre locales. Le personnage, assurément charismatique, rapidement fascinant à l'écran, s'impose par un style proche des gens, faussement paternaliste et maître dans l'art du compromis et de la conciliation. Il va faire d'Atlantic City une des plaques tournantes d'importation d'alcool par la mer.
Sous ses ordres durant ce pilote, Jimmy Damordy est, quant à lui, un vétéran récemment rentré aux Etats-Unis. Le jeune homme, profondément marqué par les horreurs de la guerre, a du mal à se ré-ajuster à la vie civile, d'autant que ces années passées loin de chez lui lui ont fait rater un vrai départ dans sa vie. Princeton n'est plus qu'un lointain souvenir, Nucky considère qu'il a manqué à ses devoirs en partant... Reste que Jimmy a une famille à charge et n'a pas peur de se salir les mains. Comme une nouvelle ère s'ouvre dans la criminalité, une carrière d'un autre genre semble devoir lui tendre les bras... Boardwalk Empire nous plonge dans un univers profondément masculin, où peu de figures féminines ont l'occasion de briller. Cependant la timide introduction de Margaret, épouse battue qui viendra demander de l'aide, offre de belles promesses sur cette dernière, en plus de montrer un autre versant de la gestion par Nucky de "sa" ville.

Boardwalk Empire nous immerge donc dans le tourbillon que représente Atlantic City, reflet des mutations en cours au sein de la société américaine. C'est toute une époque, avec ses paradoxes et ses atours clinquants, que ce premier épisode s'efforce de capter et retranscrire. Il se contente pour cela d'en esquisser les contours, prenant volontairement son temps, s'attachant plus à l'ambiance qu'aux intrigues immédiates. L'immersion fonctionne pleinement auprès d'un téléspectateur qui ne peut rester insensible à l'effort de reconstitution particulièrement abouti qui se dévoile sous ses yeux. L'écriture est dense, les protagonistes nombreux. Les enjeux ne sont pas forcément explicitement énoncés, l'observateur extérieur étant invité à prendre en route une histoire déjà en marche. Cependant, la narration est parfaitement maîtrisée, ne posant pas de problème de compréhension. C'est ainsi un cadre incontestablement complexe et intriguant qui est posé.
La première partie du pilote s'attache surtout à nous présenter les différents protagonistes et les moeurs courantes d'Atlantic City. Une remise en contexte faisant office d'introduction des plus intéressantes. Cependant, si elle a le mérite d'acclimater le téléspectateur, il lui manque une réelle dynamique narrative permettant de pleinement le captiver, tel un beau papier glacé dont on ne sait trop que faire. C'est à la seconde partie de l'épisode qu'est dévolu ce rôle : tout s'y accélère, les intrigues prennent un tour très concret, voire même létal. Dans la précipitation des évènements, chacun commence à se positionner, plus ou moins consciemment, sur un échiquier de pouvoirs et d'influences qui s'esquisse, remodelé par la prohibition. Cette construction résolument crescendo achève ainsi de conquérir le téléspectateur que le début avait laissé un peu sur la réserve.

Derrière les jeux de pouvoirs et les enjeux financiers, progressivement, la série intègre également de façon naturelle le cadre mafieux inévitable. Nous sommes à un tournant : la prohibition ne va pas seulement ouvrir un nouveau marché propice aux profits, elle va également faire prendre une autre dimension au crime organisé. Le choix d'Atlantic City comme cadre n'est d'ailleurs pas neutre ; chacun gardera à l'esprit que c'est dans cette ville que se déroulera, en 1929, le fameux sommet fondant le Syndicat du crime. En attendant, c'est le cheminement d'une décennie de restructuration, à travers les luttes intestines et l'émergence de nouvelles figures, que nous allons suivre. Si Nucky Thompson est une libre -mais proche- adaptation du réel Nucky Johnson, ce pilote offre cependant l'occasion de croiser des figures criminelles historiques, qui compteront durant la prohibition, de Lucky Luciano à Al Capone, en passant par Arnold Rothstein.
Boardwalk Empire n'est pas une simple série "de gangsters", mais elle s'en re-attribue habilement, à l'occasion, les codes narratifs pour délivrer sa propre version de quelques grands classiques du genre dont ce premier épisode n'est pas avare : des guets-apens se terminant en fusillade à l'assassinat d'un boss local dépassé par les mutations en cours, rien ne manque. Ce n'est pas pour rien si l'écriture a été confiée à Terence Winter, un ancien des Sopranos. Les parallèles avec d'autres oeuvres, notamment cinématographiques, s'imposent d'autant plus naturellement en raison de la réalisation.

Il faut dire que, sur la forme, HBO a mis les petits plats dans les grands et a confié la caméra à Martin Scorsese. C'est logiquement du grand standing, notamment pour capter l'atmosphère de l'époque ; cependant, il faut bien avouer que l'on n'en attendait pas moins d'une telle production. L'utilisation d'intermèdes musicaux, avec des chansons d'époque, se révèle être une bonne initiative. Un important travail se ressent devant les images. Tellement bien que l'on en viendrait presque à se demander si le réalisateur n'en fait pas un tout petit peu trop, notamment dans son recours à des montages de scènes en parallèle, sur fond musical, que ce soit celle du théâtre ou celle concluant l'épisode. La maîtrise est admirable, mais l'influence cinématographique est presque excessive dans ces scènes pourtant magistrales à l'écran, poussant au maximum la confusion des formats.
Enfin, côté casting, il n'y a rien à redire, si ce n'est saluer l'homogénité d'ensemble. Tous les acteurs sont parfaitement intégrés dans leurs rôles et délivrent de très solides performances. L'ambivalent Nucky Thompson est interprété par Steve Buscemi (dont les téléphages se souviendront sans doute dans The Sopranos pour ce qui est du petit écran). Michael Pitt interprète Jimmy Darmordy, et la superbe Kelly Macdonald (State of Play), Margaret Schroeder. Au sein de la distribution, on retrouve également Michael Shannon, Aleksa Palladino, Michael Stuhlbarg, Stephen Graham, Vincent Piazza ou encore Paz de la Huerta.

Bilan : Ambitieuse reconstitution d'une Amérique en pleine mutation au début de la prohibition, Boardwalk Empire délivre un pilote abouti. Sa construction scénaristique va crescendo après une première partie tout en exposition : cela lui permet de prendre progressivement la pleine mesure de son cadre et de ses thématiques. Reflet d'une époque et d'une ville particulière, Atlantic City, qui deviendra une plaque-tournante du trafic d'alcool, l'épisode pose efficacement ses enjeux de pouvoir et de gains, sur fond d'une criminalité également en pleine restructuration. C'est dense, prenant et impeccablement mis en scène. Tous les ingrédients se mettent ainsi efficacement en place, laissant entrevoir de belles promesses au téléspectateur. A la série de savoir faire fructifier et de concrétiser cette introduction réussie.
NOTE : 9/10
La bande-annonce de la série :
Le générique de la série :
15:51 Publié dans (Pilotes US) | Lien permanent | Commentaires (7) | Tags : hbo, boardwalk empire, steve buscemi, michael pitt, kelly macdonald, michael shannon, aleksa palladino, michael stuhlbarg, stephen graham, vincent piazza, paz de la huerta | ![]() Facebook |
Facebook |
19/09/2010
(Pilote NZ) This is not my life : un mystérieux thriller avec une pointe de sci-fi
You may find yourself in another part of the world.
You may find yourself in a beautiful house, with a beautiful wife.
You may ask yourself, well, how did I get here ?

La téléphagie a cela de rassurant qu'elle repose sur une réalité télévisuelle particulièrement riche et éclectique. D'où, si tant est qu'on creuse un peu, il est peu probable que l'on revienne complètement bredouille de ses explorations. Comme je vous le disais jeudi, ces deux premières semaines de septembre n'ont pas été très concluantes en terme de nouveautés. Le coup de blues sériephile commençait à poindre, en attendant peut-être le vrai lancement de la rentrée, ce soir, aux Etats-Unis. Mais la nuit de vendredi m'a remis du baume au coeur. J'ai poursuivi mes voyages téléphagiques pour mon plus grand bonheur. Non seulement j'ai craqué pour un coup de coeur japonais dont j'aurais l'occasion de vous reparler ultérieurement, mais j'ai aussi mis les pieds dans une toute nouvelle contrée jusqu'alors inexplorée : la Nouvelle-Zélande. Avec la critique du jour, c'est l'occasion d'inaugurer une nouvelle catégorie "Pilotes océanie" (ce qui me permettra d'y inclure les productions australiennes).
C'est un commentaire de Melysandre, relatif aux nouveautés de la saison à découvrir, qui avait éveillé ma curiosité il y a de cela quelques semaines. Je lui adresse encore une fois tous mes remerciements car voici bien une série qui était passée inaperçue à mon radar et dont je n'avais retenu aucun écho sur les sites que j'ai l'habitude de fréquenter : elle s'appelle This is not my life. Créé par Gavin Strawhan et Rachel Lang, dont les noms sont notamment associés aux séries Go Girls et Outrageous Fortune, ce mystérieux thriller, dont 13 épisodes ont été commandés, est diffusé sur la chaîne TV One depuis le 29 juillet 2010. Et, au milieu de ces si exotiques salutations maori qui apportent une touche de dépaysement à ce show anglophone ("kia ora !"), son pilote - d'une durée d'1h30 - s'est assuré de ma fidélité pour la suite de la série.

This is not my life se déroule dans un futur proche, puisque nous sommes en 2020. C'est suffisant pour s'offrir un cadre d'anticipation soft sans basculer dans de la science-fiction gadgétisée à outrance. L'histoire débute un matin qui aurait pu être ordinaire. Alec Ross se réveille dans une chambre d'une confortable villa, sans le moindre souvenir en tête. Il ne sait ni qui il est, ni même où il est... Sur le qui-vive, il est pourtant accueilli en descendant dans la cuisine par l'image d'Epinal d'une parfaite petite famille en train de prendre son petit-déjeuner en se chamaillant. Mais s'ils s'introduisent comme tels, il ne reconnaît ni son épouse, ni ses enfants, sa mémoire demeurant désespérément vierge de toute information. Réagissant instinctivement, il panique, cherchant à s'éloigner de ce cadre étranger... pour découvrir toute une ville aux allures policées à l'excès, du nom de Waimoana. Un lieu qui n'évoque absolument rien en lui.
Ce réveil compliqué le conduit, logiquement, à l'hôpital, pour voir le médecin de famille, sur l'insistance de sa femme. On lui raconte alors qu'il a souffert d'un choc à la tête la veille, ce qui pourrait expliquer cette étrange amnésie. Une simple opération chirurgicale devrait corriger cela. Mais la méfiance d'Alec glisse peu à peu vers une sourde paranoïa que viennent alimenter certaines remarques, poussant l'homme à s'enfuir. La découverte des règles qui régissent cet endroit, l'impossibilité manifeste de le quitter rapidement évidente, nourrissent les doutes d'Alec, sans qu'il puisse cependant faire quoique ce soit lorsque les infirmiers de l'hôpital le retrouvent enfin.

Le lendemain matin, Alec se réveille dans la même maison, devant le même cadre pseudo-idyllique. Il n'a aucun souvenir des évènements du jour précédent. S'il reste un peu confus, cette fois, lorsque ses yeux se portent sur le visage de son épouse, les souvenirs reviennent en cascade. Alors qu'il reprend peu à peu confiance en la tangibilité du monde qui l'entoure, tout est remis en cause par un bien étrange enregistrement vidéo qu'il retrouve. Avant d'être repris par les infirmiers, il s'était enregistré, insistant biien sur le fait qu'il n'est pas "Alec Ross" et que "ce n'est pas sa vie"...
Dans le cadre si surveillé de Waimoana, il va devoir redoubler de prudence pour percer le mystère que cette ville dissimule, afin de découvrir qui il est vraiment, mais aussi ce qui se cache derrière le vaste mensonge que semblent être leurs vies manipulées.

L'atout majeur de This is not my life réside incontestablement dans l'efficacité avec laquelle son mystère va être posé. L'ambiance générale de la série prend rapidement un tour résolument paranoïaque, le moindre détail le plus anecdotique faisant naître la suspicion dans l'esprit d'un téléspectateur qui est prend naturellement fait et cause pour Alec Ross. Si cette atmosphère poussant à la sur-interprétation pouvait faire craindre un recours excessif aux sous-entendus, la fiction va bâtir son intrigue sur des faits tangibles. S'il demeure une part de non-dit, d'inexpliqué, si des ressorts nous échappent encore, en raison du manque de certaines informations, la série, elle, ne tergiverse pas : notre inquiétude se trouve rapidement confortée par les évènements auxquels nous assistons.
En fait, en terme de filiation téléphagique, reconnaissons qu'il règne incontestablement comme un faux air du Prisonnier sur la ville si parfaite de Waimoana. Même si son cadre lui est propre, il est difficile de ne pas faire de parallèles avec cette série - voire avec d'autres fictions déclinant ce thème de la ville factice où le héros s'inscrit en porte-à-faux, comme The Truman Show. On retrouve ainsi dans This is not my life un certain nombre de thématiques et de ressorts narratifs familiers, qu'elle est cependant en mesure de se réapproprier de manière convaincante. L'approche reste classique, mais n'en est pas moins efficace.

Au fur et à mesure que le pilote progresse, l'indubitable impression d'artificialité de la ville se renforce donc. L'évidence que quelque chose cloche s'impose à Alec, comme au téléspectateur. Dans cette culture du mystère, la force de la série va finalement résider dans sa simplicité. De façon imperturbable et solide, elle capitalise et explore son concept. Inutile de trop en faire dans un suggestif qui deviendrait rapidement lourd, pas besoin d'étirer inutilement les choses en longueur... Ce premier épisode ne perd pas de temps en exposition inutile, mené sur un rythme enlevé. Une pointe d'action, des drames, la perte de certains repères, les nerfs qui lâchent, tout s'enchaîne efficacement et les suspicions du héros se confirment.
Ce pilote apporte ainsi au téléspectateur suffisamment d'évènements concrets pour offrir de solides fondations à cette atmosphère de thriller qu'il distille. Mine de rien, c'est toute une mythologie qui s'esquisse avec un minimum de ressources. Par rapport à d'autres séries du genre qu'on a trop souvent vu s'égarer dans les méandres creuses d'une introduction pompeuse, voici une approche directe qui a le mérite d'être rafraîchissante. Qui est Harry ? Quel est ce lieu ? Comment les forces de sécurité de la ville sont-elles en mesure d'exercer une surveillance permanente sur chacun ? Et, peut-être la plus troublante des questions, qui conclut l'épisode, comment est-il possible de "remplacer" un adolescent par un autre, manipulant non seulement la mémoire de ce dernier, mais également celle de chaque habitant ? Au terme de cette heure et demie, nous aboutissons donc à un intrigant mystère. Toutes les questions, qui se bousculent dans la tête d'un héros soudain écrasé par l'ampleur du phénomène auquel il est confronté, trouvent un écho particulier auprès d'un téléspectateur à la curiosité plus qu'aiguisée. De quoi s'assurer de sa fidélité pour la suite.

Par ailleurs, un autre aspect mérite d'être salué, il s'agit de la manière dont This is not my life construit son cadre, permettant de renforcer son ambiance confusément troublante. Je ne sais pas quel est l'état de santé financier de l'industrie télévisuelle néo-zélandaise, mais il est évident que la série n'a pas à sa disposition des moyens budgétaires démesurés. Toute la difficulté va être de parvenir à mettre en scène une série de semi-anticipation, se déroulant dans une décennie, avec un minimum d'effets spéciaux.
Si la technologie subit quelques améliorations, la série n'essaye pas de se lancer dans une surenchère perdue d'avance dans cet aspect gadgétisé, n'étant pas en mesure de re-créer un cadre futuriste à la Caprica, par exemple. C'est par sa seule esthétique - particulièrement soignée - que This is not my life va parvenir à un résultat sobre mais abouti, qui est loin d'être inintéressant. Le décor est épuré, presque clinique. Une impression que renforce la photographie de la série : celle-ci se décline dans des couleurs pastels froides, à forte dominante de blanc, de bleu et de gris. Cela accentue le côté excessivement policé et lisse renvoyé par cette ville, permettant ainsi de jouer sur le contraste entre cette apparente perfection qui sonne faux et les secrets qui sommeillent derrière, masquant des réalités plus perturbantes.

Sur la forme, This is not my life propose donc une oeuvre travaillée et recherchée. Ses moyens limités ne l'empêchent pas de faire preuve d'initiative et de savoir pleinement exploiter tout le potentiel qu'elle a à disposition pour délivrer un cadre qui apporte une réelle valeur ajoutée. De manière générale, la réalisation demeure classique, tout en s'offrant un certain nombre de plans plus larges qui illustrent l'effort réalisé pour poser une ambiance. Si la bande-son, surtout instrumentale, n'est pas des plus maîtrisée, donnant parfois l'impression d'être un peu brouillonne, elle ne dépareille cependant pas.
Quant au casting, la performance d'ensemble est globalement solide. On retrouve en tête d'affiche un acteur familier des téléphages, Charles Mesure (Xena/Hercule, Preuve à l'appui, Outrageus Fortune, V). Si j'étais un peu sceptique au départ, j'ai été assez agréablement surprise par la densité de son jeu ; il s'impose en effet de façon plutôt subtile et assez crédible. A ses côtés, Tandi Wright (Seven Periods with Mr Gormsby, Serial killers) incarne sa femme. Tania Nolan (Go Girls) joue une docteur des plus troublantes.

Bilan : Construit comme un thriller, le pilote de This is not my life se charge de nous introduire dans un mystère des plus intrigants. Posant efficacement les bases de sa mythologie, l'épisode exploite pleinement tous les (modestes) moyens qui sont à sa disposition pour aiguiser la curiosité d'un téléspectateur rapidement happé par cette ambiance paranoïaque et inquiétante. Derrière ses faux airs d'un Prisonnier où viendrait poindre une touche d'anticipation futuriste, il est impossible de savoir dès à présent quelle orientation prendra This is not my life. Basculera-t-elle pleinement dans la sphère de la science-fiction ? Est-ce une intervention humaine ou venue d'ailleurs qui se cache derrière la ville de Waimoana et ses allures paradisiaques ? Voici en tout cas une fondation solide pour débuter une série.
En résumé, This is not my life est une agréable surprise et une première incursion réussie dans la télévision néo-zélandaise. Elle sait capitaliser sur son concept de départ très fort sans tergiverser. C'est aussi dans cette simplicité et cette sobriété que réside sa force, évitant la tentation à laquelle ne surent pas résister d'autres fictions du genre trop promptes à étaler des ambitions pompeuses qu'elles ne purent jamais confirmer.
NOTE : 7/10
La bande-annonce de la série :
10:21 Publié dans (Séries Océanie) | Lien permanent | Commentaires (6) | Tags : nouvelle-zélande, tv one, this is not my life, charles mesure, tania nolan, tandi wright | ![]() Facebook |
Facebook |
18/09/2010
[TV Meme] Day 5. A show you hate.

Desperate Housewives
(2004-.., ABC)
Il est assez difficile d'expliquer rationnellement le pourquoi de ce choix. Desperate Housewives, actuellement, ce serait une série dont je n'aurais pas dépassé les deux ou trois premiers épisodes. Nous nous serions quittés sans rancune, dans l'indifférence générale, et je l'aurais vite oubliée, ne conservant en sourdine qu'un buzz lointain dans les médias. Malheureusement, ma rencontre avec cette série eut lieu en 2004-2005. A une époque où je me dis que je manquais sans doute encore de recul dans ma façon de vivre ma passion pour les séries.
Devant le succès qui accompagna sa première saison, je m'étais naïvement persuadée qu'il était possible de percer les raisons de cet étrange engouement : un besoin de compréhension vaguement masochiste m'amena donc à persévérer... au-delà du raisonnable. Pour être franc, la question "qu'est-ce que le public peut bien trouver à Desperate Housewives ?" fut un des deux grands mystères de cette saison téléphagique 2004-2005 (L'autre grand mystère consistait à s'interroger sur le phénomène Lost. Je crois d'ailleurs que c'est cette saison-là qui consacra probablement mon divorce avec une certaine télévision américaine ; et comme ce désamour me prit un peu par surprise, cela explique aussi mon obstination sur le moment).
Mes premières impressions sur Desperate Housewives n'avaient pas été très positives. Derrière son fil narratif tiré à quatre épingles, elle me semblait surtout excessivement creuse, un peu vaine et pas vraiment divertissante, proposant un portrait banlieusard étriqué d'un certain milieu qui ne suscitait en moi qu'une profonde envie d'ailleurs. Je n'aimais pas l'image renvoyée, je n'aimais pas la tonalité. Certains clichés m'horripilèrent. L'état d'esprit m'agaça. J'étais en plus insensible aux piques d'humour supposé de cette dramédie. Mon erreur fut de m'entêter et de poursuivre jusqu'au bout de la première saison... Mon seuil de tolérance avait été dépassé depuis bien longtemps lorsqu'elle se conclut. Si je reconnais que cette fiction ne mérite probablement pas le ressentiment que j'ai gardé à son encontre, l'effort que j'ai produit pour elle - et les débats stériles que j'ai pu avoir sur les forums - fait que j'en conserve une allergie tenace.
Pourtant, je lui suis reconnaissante sur un point. Son grand mérite a été de m'avoir fait mûrir téléphagiquement : elle m'a définitivement guéri de ce besoin naturel à tout téléphage socialisant qui est de vouloir "faire comme tout le monde". Grâce à elle, je me suis affranchie cette sourde inquiétude. Chacun ses affinités, et tout le monde se porte mieux. Il faut se faire une raison, je ne suis pas quelqu'un qui peut suivre une série sur le long terme juste pour une histoire de culture télévisuelle (même pour des monuments téléphagiques considérés comme incontournables), ou pour pouvoir ensuite donner son opinion "éclairée" (fut-elle négative). Forcer sa nature ne mène à rien, ce fut une leçon douloureuse, mais instructive.
Donc, sans rancune envers Desperate Housewives (il en fallait bien une qui m'apporte cette expérience)... si ce n'est que... non, je ne l'aime vraiment pas cette série ! (Même si je comprend bien, du moins sur un plan théorique, pourquoi elle a pu (et peut toujours ?) plaire.)
07:24 Publié dans (TV Meme) | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : tv meme, abc, desperate housewives | ![]() Facebook |
Facebook |
16/09/2010
(Pilote CAN) Lost Girl : succube & fae pour du fantastique cheap au rabais
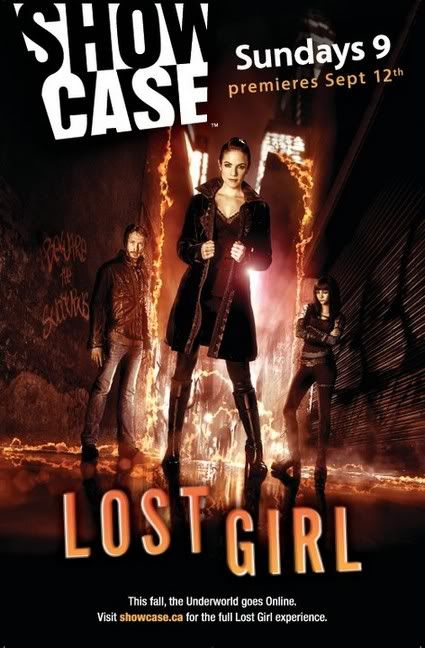
Dans la lignée de la morosité de ces premières escarmouches de rentrée, les pays changent (remarquez que je fais des efforts en terme de nationalités traitées), mais la tonalité demeure invariable, et le Canada n'est pas en reste. Dimanche dernier, la chaîne Showcase y lançait une nouvelle série, Lost Girl, surfant sur cette vague fantastique qui fleurit actuellement un peu partout dans nos petits écrans. Une fiction qui promettait d'explorer toute la diversité des créatures de l'étrange, avec pour héroïne rien moins qu'une succube. Les rayonnages dérangés de ma bibliothèque trop bien garnie en bit-lit comprenant les deux premiers tomes des aventures de Georgina Kincaid, je mesurais ainsi à peu près le potentiel narratif du concept de départ.
C'est que j'ai une confession à vous faire : je cultive un penchant déraisonnable pour le fantastique cheap. Ce genre de série pas prétentieuse pour un sou, mais diablement divertissante - telle Blood Ties par exemple - a pu me faire passer d'excellents moments devant mon petit écran. Si bien que c'était avec un esprit ouvert, sans a priori, que j'étais prête à découvrir Lost Girl, même si la bande-annonce avait fait naître quelques craintes à son égard... Craintes malheureusement plus que confirmées par le pilote.

La Lost Girl intronisée héroïne par la série s'appelle Bo. La jeune femme mène une vie loin d'être sédentaire, devant régulièrement rassembler au plus vite ses affaires pour s'enfuir. Car Bo n'est pas une femme ordinaire. Derrière une assurance de façade, à l'évidence endurcie par les épreuves de la vie, son quotidien consiste à gérer des facultés dont elle ne comprend ni la nature, ni la manière dont elle pourrait les maîtriser. Si ses capacités lui simplifient la vie à l'occasion, puisqu'elle parvient à manipuler ses interlocuteurs par un simple contact, elles échappent parfois de manière fort dangereuse à tout contrôle : lorsqu'elle embrasse quelqu'un, elle aspire la vie de cette personne par la même occasion. Incapable de s'arrêter, c'est ainsi qu'elle laisse régulièrement des cadavres derrière elle.
Au début de ce premier épisode, Bo travaille comme barmaid. Elle sauve une cliente, Kenzi, qu'un homme avait drogué, espérant ainsi pouvoir abuser d'elle en toute impunité. L'intervention de Bo ne s'opère pas sans dommage, puisqu'emportée dans le feu de l'action, son baiser létal tuera le criminel. Passée la frayeur des premiers instants, avec une Kenzi dépassée par ce à quoi elle a assisté, les deux jeunes femmes font plus amplement connaissance, nouant rapidement une certaine complicité.
Mais le meurtre commis par Bo la rattrape : elle est arrêtée par une bien étrange brigade... dont les membres n'appartiennent pas seulement à la police. Elle découvre alors un autre versant de ce monde dont elle n'avait jamais soupçonné l'existence : une société de fae (terme générique regroupant toutes les créatures surnaturelles), structurée et hiérarchisée, se cachant dans l'ombre. Une organisation mise en émoi par l'arrivée d'une inconnue qui attire de manière inconséquente l'attention sur eux. Plus que le mort, c'est la non affiliation de Bo à l'un des deux camps institués, "le bien vs. le mal" pour faire synthétique, qui perturbe le plus ces derniers. Qui est donc Bo ? Pourquoi son existence avait-elle été maintenue secrète jusqu'à présent ? Cet autre univers qui s'ouvre à la jeune succube va sans doute être source de plus d'interrogations que de réponses...

A partir de ces bases fantastiques qui ne demandaient donc qu'à s'affirmer, Lost Girl s'inscrit dans un créneau cheap à l'excès, parfaitement assumé, sur le fond comme sur la forme. Dans son contenu, la série fait preuve d'une relative et malhabile subtilité, dont je soupçonne fortement le caractère involontaire. En effet, si elle exploite des allures excessivement manichéennes, ces dernières semblent, paradoxalement, plus conduire la série dans une zone grise et floue, où il apparaît bien difficile de distinguer le mal ou le bien en dépit de supposés camps clairement délimités. Les deux souhaitent la mort de l'intruse, ce qui les confond d'emblée, surtout aux yeux du téléspectateur. Finalement seul le policier venant en aide à Bo est présenté sous une lumière un tant soit peu positive.
Mais ce flou moral est également entretenu par notre héroïne : elle admet ne pas contrôler ses pouvoirs, qu'elle n'hésite cependant pas à utiliser. Elle est incapable à l'occasion de résister à la faim ; et elle tue bel et bien un homme en début d'épisode... Cependant, le message subliminal de Lost Girl est clair : ce dernier était un criminel, avec des antécédents qui plus est, permettant de faire glisser Bo dans des habits de justicière. C'est à peine si cette mort fait ciller les protagonistes, chacun étant plus concentré sur la nature de succube de la jeune femme. Si bien que l'on a finalement l'impression que les scénaristes, avec une naïveté un peu grossière, jouent avec leur attrayant concept, sans oser pleinement le mettre en scène. Voulant présenter leur héroïne comme indépendante, ils tendent inconsciemment à la détacher des contingences morales. Mais, dans le même temps, c'est avec un traitement scénaristique réinvestissant le champ des codes des super-héros qu'ils l'introduisent, souhaitant à l'évidence cultiver une certaine sympathie à son égard. Une ambivalence de traitement qui laisse un arrière-goût d'inachevé, devant une construction tour à tour maladroite et excessivement timorée.

Au-delà du cadre binaire assez rigide qu'elle pose, Lost Girl s'avère être d'une prévisibilité vite lassante, dont les dialogues sonnent trop creux pour réveiller l'intérêt du téléspectateur. La faiblesse des moyens alloués à la réalisation, comme aux pseudos effets spéciaux, lui permet de soigner ce faux premier degré apparent pour se créer une ambiance au rabais, qui renvoie à un univers de série B, d'où percent d'importantes pointes comics. Tout au long de l'épisode, elle frôle constamment la trop fine frontière du ridicule, qu'elle finit par franchir allègrement à plusieurs reprises. Cela ne serait pas handicapant en soi si la série savait faire preuve d'une distance plus maîtrisée avec son contenu et n'oubliait pas le registre du divertissement. Malheureusement loin du cheap fun et versatile de certaines fictions, c'est plutôt dans un registre indigeste et assez pesant que Lost Girl va s'affirmer.
Si la série peine à trouver ses marques sur la forme, les acteurs ne semblent pas non plus particulièrement concernés, les lignes de dialogues ne motivant sans doute pas trop pour gagner en crédibilité. On retrouve pourtant quelques têtes familières au casting. Bo est incarnée par Anna Silk (croisée en guest dans Being Erica). A ses côtés, figurent Zoie Palmer (The Guard), Kristen Holden-Reid (The Tudors) ou encore Ksenia Solo (quelques apparitions dans Life Unexpected la saison dernière).

Bilan : Du cheap divertissant au ridicule pesant, il n'y a souvent qu'un pas. Lost Girl bascule malheureusement trop aisément dans le second versant. Pour une série fantastique mettant en scène des fae, elle se ré-approprie paradoxalement beaucoup plus de codes scénaristiques propres aux fictions de super-héros que ceux du surnaturel plus traditionnel. Cela lui permet de soigner une atmosphère très série B, dans laquelle il manque l'ingrédient sans doute le plus important, le divertissement (les sourires générés involontairement par certaines lignes de dialogue ne pouvant être comptabilisés comme un second degré volontaire). A la fois excessivement manichéenne, tout en ayant l'irrésistible envie de brouiller un peu les cartes sans l'oser vraiment, Lost Girl n'assume pas pleinement le registre qu'elle a choisi d'investir en prenant une succube comme héroïne...
En somme, je ne suis pas certaine qu'il y ait grand chose à sauver dans cette série. Si je me laissais aller aux comparaisons, je la classerais sans doute dans la droite lignée d'un Demons, tant au niveau des moyens budgétaires que de l'univers mis en place. A oublier.
NOTE : 3,25/10
La bande-annonce :
07:50 Publié dans (Séries canadiennes) | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : showcase, lost girl, anna silk, zoie palmer, kristen holden-reid, ksenia solo | ![]() Facebook |
Facebook |
15/09/2010
(Pilote / K-Drama) Sungkyunkwan Scandal : un highschool drama en costumes

En ce mercredi asiatique sur le blog, la Corée du Sud n'échappe pas au sentiment de relative insatisfaction qui domine pour l'instant la rentrée ; mais, rassurons-nous, le meilleur reste à venir. Pour être honnête, il est vrai que je doutais fortement, avant même de m'installer devant ces deux premiers épisodes, de la capacité de Sungkyunkwan Scandal à m'intéresser. Disons que j'aurais essayé sans préjugé de donner une chance à cette nouvelle série diffusée sur KBS2 depuis le 30 août dernier et que l'essai ne fut pas concluant.
Je reconnais que les cross-dressing shows ont leur charme. Les sud-coréens semblent avoir un goût prononcé - sur lequel il faudrait un jour sociologiquement se pencher - pour ces twists narratifs improbables générés par une héroïne déguisée en garçon, sans doute en partie en raison de leur amour des quiproquos. Le résultat est d'ailleurs généralement au rendez-vous. Coffee Prince reste une référence en la matière, mais les Painter in the wind et autre You're Beautiful ont prouvé que le format pouvait se décliner dans des univers très différents. Cependant j'avais bien deviné que mon principal souci avec Sungkyunkwan Scandal risquait de se situer à un autre niveau : le cadre dans lequel il se déroule. Parce qu'au-delà du décor historique, ce sont bien les codes narratifs d'un classique high school drama (ou d'université, si vous préférez) qui sont recyclés. Or j'ai sans doute déjà dû vous mentionner une vieille overdose que j'ai faite il y a quelques années avec des j-dramas sur ce thème. Désormais, c'est un genre que j'aurais plutôt tendance à fuir. Si bien que, en dépit d'un mélange au final pas inintéressant, il est probable que Sungkyunkwan Scandal demeure à mon goût fondamentalement trop "high school drama", du moins dans ces deux premiers épisodes.

Ce drama nous plonge sur les bancs et dans les coulisses de la prestigieuse université de Sunkyunkwan, qui fut fondée à la fin du XIVe siècle. Se déroulant sous Chosun, il se propose de suivre le quotidien mouvementé d'étudiants, entre romance et concurrence. A l'époque, l'établissement de haute renommée est uniquement ouvert aux hommes (si possible de descendance noble), tant il apparaît inconcevable qu'une femme reçoive une éducation. Kim Yoon Hee va ainsi venir bouleverser bien des traditions. Appartenant à une famille pauvre et endettée, seule valide à la maison, son frère, malade, restant allité, la jeune femme a pris l'habitude de se travestir pour pouvoir exercer ses talents comme scribe, mettant ses qualités d'écriture au service des tours de passe-passe et autres tricheries organisées qui rythment la vie des quartiers étudiants proches de l'université de Sunkyunkwan.
Prête à tout et dotée d'un caractère bien trempé, Yoon Hee prend tous les risques pour subvenir aux besoins de sa famille, et surtout se sauver face à un créancier se faisant de plus en plus menaçant et caressant l'espoir de "l'acquérir". Elle va participer à l'organisation de fraude lors de l'examen d'entrée à Sunkyunkwan. Au cours de ses pérégrinations agitées dans ces coulisses estudantines, bien que déguisée en garçon, elle exerce déjà une certaine fascination auprès de jeunes gens qui, à la différence d'autres cross-dressing show, devinent rapidement qu'ils ont à faire une femme. C'est ainsi que son quotidien mouvementé va l'amener à rencontrer le fils d'un ministre important, Lee Sun Joon, intransigeant jeune homme qui ne doute de rien, Goo Yong Ha, un playboy qui se laisse vivre, et Moon Jae Shin, une sorte de rebelle moitié looser difficilement catégorisable.
L'enchaînement des évènements l'amènera jusqu'à la dernière épreuve d'admission à l'université, à laquelle le roi assiste. Après plusieurs twists et autres retournements de situation, le tout se concluant par un ordre du roi de rejoindre les rang de Sunkyunkwan, Yoon Hee se résoudra finalement à faire sa "rentrée scolaire", sous le nom de son frère. Cela offrira à ce dernier l'accès à des soins gratuits, tout en permettant à sa soeur de bénéficier d'une éducation dont son sexe la priverait normalement. Evidemment, ses soucis au sein d'une université où elle va devoir feindre d'être un garçon jusque dans le dortoir, ne font que commencer...

Si le premier élément qui attire l'attention, dans Sungkyunkwan Scandal, apparaît être un résolu mélange des genres, la série donne avant tout l'impression, au cours de ses premiers épisodes, d'être un high school drama en costumes, le cadre historique tenant alors plus du décor exotique. Tensions des examens, tricheries, arrogance d'anciens élèves, bizutage, aucun ingrédient du genre ne manque à l'appel. Les scénaristes optent en fait pour une radicale modernisation des moeurs estudantines au sein de l'université, préférant s'octroyer plus de liberté pour peut-être mieux toucher le téléspectateur sur un terrain qui lui sera familier.
Si bien qu'on a finalement le sentiment récurrent que l'histoire pourrait tout aussi bien se dérouler dans le présent en conservant quasiment les mêmes ficelles. Seules quelques spécificités culturelles historiques se chargent de nous rappeler, à l'occasion, l'époque. Il y a bien un roi, et il est fort probable qu'un complot sera exhumé derrière les regards en coin de ses conseillers, au cours du drama, mais l'atmosphère qui règne sur ce campus est plus proche de celle que l'on utiliserait pour décrire un tel lieu de nos jours. Ainsi, l'initiative de mêler historique et high school drama qui aurait pu, si ce n'est intriguer, au moins paraître singulièrement originale, échoue à trouver une réelle justification à l'écran, la série peinant à trouver une homogénéité entre tous ces aspects.

Si Sungkyunkwan Scandal ne réussit pas véritablement à imposer et transposer son concept de départ à l'écran, c'est aussi en partie en raison de l'extrême classicisme des ficelles employées : le drama maintient le téléspectateur avec un arrière-goût de déjà vu dont la série ne parvient, à aucun moment, à se départir. Certes, on retrouve bien, par intermittence, une pointe de fraîcheur innocente dans l'écriture, mais l'ensemble manque considérablement de spontanéité et de liant. Tout y est prévisible à l'excès. A partir d'une base déjà mille fois vue, celle d'une héroïne issue de milieu populaire et de jeunes gens héritiers de puissants, tout s'enchaîne comme le téléspectateur un tant soit peu familier des kdramas s'y attendrait. Sauf qu'en plus, tout manque de cohésion, les storylines et leurs coïncidences nombreuses se succèdant de façon saccadée, excessivement téléphonées ou bien maladroitement parachutées. Les deux premiers épisodes peinent ainsi à trouver un rythme consistant, et l'intérêt du téléspectateur vacille au gré de ces aléas.
Pour autant, plus qu'une relative fragilité scénaristique, c'est la difficulté que vont éprouver les personnages pour s'imposer qui va peut-être le plus gêner ; et qui, dans un kdrama, est sans doute la plus dommageable. L'alchimie n'opère en effet pas systématiquement dans les relations entre les protagonistes. S'il n'y a rien à redire sur Yoon Hee, la jeune femme s'insérant parfaitement dans les canons des figures féminines du genre, le problème se pose surtout du côté des personnages masculins. Parmi eux, seul Goo Yong Ha, figure un peu creuse, mais versatile et volatile à souhait, du playboy revendiqué, s'en tire honorablement. A l'inverse, monolithique à l'excès, trop unidimensionnel, Lee Sun Joon reste en retrait, tranchant presque avec le dynamisme global, pas toujours pleinement maîtrisé, que l'on sent poindre dans le drama à travers la mise en scène des coulisses d'une université. Et lorsque le personnage principal du drama convainc aussi peu, cela devient rapidement problématique. Enfin, si la troisième figure masculine n'a pas encore été suffisamment développée pour que l'on puisse émettre un jugement, le peu laissé entre-aperçu m'a plus inquiétée que rassurée sur l'épaisseur du personnage.

Sur la forme, Sungkyunkwan Scandal bénéficie d'une réalisation de bon standing. Résolument moderne, chatoyante à l'excès, avec quelques effets de caméra plutôt agréables à l'oeil, le drama prend assurément la pleine mesure de son décor. S'il éblouit moins que ce que les flashbacks du passé, dans My Girlfriend is a Gumiho, peuvent faire actuellement, cela demeure un résultat très solide. La bande-son quant à elle est pour le moment un peu en retrait, mis à part la chanson de fin. Sur le plan de la musique, la série devrait donc sans doute gagner en assurance progressivement.
Au niveau du casting, l'impression est nuancée, voire très mitigée, sans que l'on puisse clairement distinguer les responsabilités entre les scénaristes et les acteurs. Park Min Young (que j'avais déjà trouvée charmante dans Running Gu cet été) est celle qui s'en sort le mieux, incarnant une héroïne rafraîchissante et dynamique. C'est tout l'inverse de son vis-à-vis masculin, Micky Yoochun, dont l'interprétation m'a rapidement agacée, manquant sérieusement d'énergie. Il m'a semblé aux abonnés absents durant la majeure partie des deux épisodes. Yoo Ah In (The Man Who Can't Get Married), lui, n'est guère aidé par la caricature indigeste d'apprenti rebelle qu'il hérite comme personnage. Au final, parmi les trois, celui qui s'en tire le mieux est sans conteste Song Joong Ki (Obstetrics and Gynecology Doctors) qui surjoue allègrement un rôle de playboy dans lequel il s'amuse à l'évidence beaucoup, et son enthousiasme a au moins le mérite de se ressentir.

Bilan : High School Drama en costume, tenant plus de la série estudantine que du sageuk, Sungkyunkwan Scandal peine à trouver son rythme durant ses deux premiers épisodes. Dotée d'intrigues prévisibles à l'excès, elle manque singulièrement de consistance sur le fond, alors même qu'elle ne réussit pas à compenser cette faiblesse par le développement d'une dimension humaine qui reste insuffisamment travaillée, plombée par un personnage masculin principal ne parvenant pas à s'imposer à l'écran. Trop inégale dans ses storylines comme dans ses personnages, il lui manque sans doute une bonne dose de spontanéité et de fraîcheur pour atteindre une homogénéité nécessaire et qui lui permettrait d'investir avec plus d'aplomb son versant émotionnel.
NOTE : 4/10
La bande-annonce de la série (sous-titrée anglais) :
La chanson de l'OST (que l'on entend notamment en fin d'épisode) :
08:53 Publié dans (Séries asiatiques) | Lien permanent | Commentaires (9) | Tags : k-drama, sungkyunkwan scandal, micky yoochun, park min young, song joong ki, yoo ah in, seo hyo rim | ![]() Facebook |
Facebook |



